~ 1 ~
Comme
toute histoire, la véritable histoire du rock a une préhistoire.
Plus tard j’apprendrais que la préhistoire a elle-même une
préhistoire : la prépréhistoire. Et que cette prépréhistoire...
mais bon, n’allons pas plus vite que la musique et tenons-nous en à
la préhistoire pour l’instant. Quand il faudra étoffer le propos,
nous saurons nous souvenir qu’aucun miracle ne tombe du ciel. Pour
l’heure nous sommes en colonie de vacances en 1960, et chaque jour
avant l’heure des repas, dans la grande salle qui donne accès au
réfectoire, nous est accordée une petite demi-heure apéritive pour
danser le twist et le rock en compagnie des filles, précision
d’autant plus importante que la mixité n’a encore fait son
apparition nulle part et que du haut de mes dix ans quelque chose
d’inaugural m’apparaît confusément, même si je ne sais pas
encore que ma destinée sera rock pour le meilleur et pour le pire ou
ne sera pas.
Quels
45 tours les enfants de la colonie de vacances ont-ils le bonheur de
mettre sur l’électrophone en 1960 ? Richard Anthony avec “Tu
parles trop” ou “Le petit clown de ton cœur”, Johnny Hallyday,
avec “Souvenirs, souvenirs” ou “Itsy Bitsy petit bikini”, les
Platters avec “Only you”, Paul Anka avec “Diana”, Dalida avec
“T’aimer follement” ou “Itsy Bitsy petit bikini” à
nouveau, Danyel Gérard, mais c’est d’autant plus “Apache”
des Shadows qui mène la danse qu’avec ce morceau se terminera la
session lors de la fête de clôture. L’année suivante, dans cette
même colonie de vacances, en compagnie des mêmes petites
amoureuses, Maryse, Marie-Josée, viendront s’agréger Petula Clark
avec “Romeo”, Adriano Celentano avec “24000 baci”, les
Chaussettes noires, les Chats sauvages, et encore les Shadows avec
“F.B.I.” et les nouveaux postulants que l’on sait.
Jusqu’ici
le rock est une histoire d’enfance, je dirais même d’enfance de
l’art. Nul indice avant-coureur d’un conflit de générations
mettant face à face Tino Rossi qu’aimait ma mère et Richard
Anthony. La musique c’était les 78 tours paternels, immuables car
mes parents n’avaient pas de budget musique, également ce qu’il
leur arrivait de fredonner et qui me revient parfois : “Le
Bricoleur” de Patachou, “C’est l’piston” de Bourvil, etc.
Mais musique et chanson c’était avant toute chose la TSF, la
télévision n’ayant pas encore fait main basse sur les
consciences, et la TSF ce n’était pas que des “Ploum ploum
tralala”, c’était le sketch hebdomadaire de Simons : “Acoutez
l’Vaclette (L’Conte du vinderdi)”, Alain Decaux, André
Castelot et Colin-Simard avec “La Tribune de l’Histoire”, Jean
Nocher avec sa chronique “En direct avec vous”, Geneviève
Tabouis à la voix inoubliable, sans oublier “Les Maîtres du
mystère”, “L’Homme à la voiture rouge” ou “De l’autre
côté du soleil”. La TSF c’était un imaginaire.
Arriveront
les chapitres où il me faudra évoquer les cinoches, le marché de
Wazemmes, mes petites amoureuses, le dessin, ce qu’est une destinée
rock, etc. tout ce qui fit et fait encore l’entour, et pourquoi pas
le catéchisme pendant que j’y suis ? Pour l’instant je voudrais
encore dire un mot sur le Sébasto devant lequel je passais chaque
jour pour aller à Michelet, l’école Michelet. Sébasto ce fut
“L’Auberge du Cheval blanc” et “Le Chanteur de Mexico” avec
Luis Mariano et je suis prêt à jurer que ces deux opérettes
auxquelles nous assistâmes furent décisives. À cette époque,
hormis “Carmen”, mon père jugeait l’opéra hermétique,
fastidieux et, comme par un fait exprès, en langue étrangère,
fût-ce quand c’était en français. Seule une classe sociale
gardienne du sésame l’appréciait. Et c’est peut-être bien
parce que “Carmen” est un opéra-comique que via un malentendu, à
moins que ce ne fût une ruse, il pouvait l’apparenter aux “Cloches
de Corneville”. En tout état de cause pas plus que “Carmen” je
ne vis d’opéra ni d’autres opérettes que ces deux-là à cette
époque. Quel rapport avec l’art lyrique me demanderez-vous
peut-être ? Le rock ? Aucun, mais le postrock, si. Car si le rock
eut une préhistoire, il a fatalement une posthistoire. Patience,
nous y viendrons en temps et en heure...
(Le
terme “opéra-comique”, variante française d’“opera buffa”,
désignait à l’origine un opéra qui, comme son nom l’indique,
était comique, par opposition à “opera seria”. Comme dans ces
opéras comiques, formellement moins encombrés que dans les “opere
serie”, il y avait des parties parlées, un glissement sémantique
a fini par attribuer le terme “opéra comique” à tout opéra
comportant des dialogues parlés. Ainsi “Carmen” ou “Fidelio”
qui n’ont rien de comique se sont-ils retrouvés affublés de ce
qualificatif.)

avec Chris Farlowe
~ 2 ~
Du
catéchisme je n’ai pas grand-chose à dire. Je vais donc en
toucher trois mots rapidos pour être débarrassé. Nous sommes
maintenant en 1963, en 5ème, piètre élève, Baggio trop violent.
C’est cette froide année-là que j’apprends par l’abbé
Declercq qu’il ne suffit pas que de dormir côte à côte pour
avoir des enfants, puis par le médecin scolaire qu’il faut
décalotter son zizi sous peine de je ne sais quelles affres, et que
place de la Nation 150 000 jeunes assistent au concert gratuit des
Gam’s, Chats sauvages (avec Mike Shannon), Frank Alamo, Danyel
Gérard, Richard Anthony, Sylvie Vartan et Johnny Hallyday. Mon
copain Bernard m’appelait “p’tit curé” parce que je suivais
ce que nous enseignait l’abbé Soyez avec le plus grand sérieux.
Comment m’aurait-il appelé trente ans plus tard s’il m’avait
vu suivant avec le même sérieux des cours sur la mécanique
quantique auxquels je ne comprenais que tchi ? Outre le fait que je
n’ai jamais été un turbulent, le catéchisme m’intéressait
parce qu’il était précédé d’une messe rassemblant garçons et
filles, les garçons d’un côté de l’allée centrale, les filles
de l’autre avec là-bas celle qui faisait battre mon cœur,
Josette. Pour tout émoi horriblement éloigné de son objet mais
tellurique, je n’avais droit qu’à cet office hebdomadaire car en
ce temps-là les pères tenaient leurs enfants d’une main de fer,
notamment le mien. Quel tube aurait rapporté une telle infortune ?
C’est qu’avec le twist, le fond de l’air était gai, n’est-ce
pas ! Le monde entier twistait...
Avec
l’approche de la communion solennelle advint l’affaire des boots
! Ah, l’affaire des boots, aussi cataclysmique que l’affaire de
la malle sanglante de Millery, c’est elle qui dans la genèse fait
la jonction entre le rock, autant dire le diable, et le bon dieu ! Le
costume de communiant du plus beau bleu qui soit était là, le
brassard était là, la cravate était là, la chemise blanche était
là, l’amidon pour le col de la chemise était là, ne manquaient
que les souliers que ma mère et moi allâmes chercher chez “Marcel”,
le chausseur de la rue Jules Guesde. Ma mère ne voyant pas
d’objection à ce que mon choix s’arrêtât sur, rutilante entre
toutes, une paire de boots Chelsea semblable à celles que portaient
les Beatles, c’est avec cette paire de boots et le sentiment du
devoir accompli que nous rentrâmes à la maison. Pourtant, quel
sacrilège ne venais-je pas de commettre ! Quand mon père découvrit
ces chaussures d’infamie à soufflets et bouts pointus, il lui prit
une poussée d’adrénaline à faire déguerpir le voisinage,
exigeant qu’on allât sur le champ les échanger, chose qui, la
dissipation des jours suivants aidant, ne se fit heureusement pas.
Cette sacrilège intrusion de chaussures sorties droit de l’antre
de l’antéchrist invalida-t-elle ma profession de foi ? Toujours
est-il que “la fin de la religion obligatoire” selon Luc Perrin
donnant droit à un cadeau je reçus, outre la paire de boots
Chelsea, un poste transistor Atlantic qui via l’émission “Salut
les copains” m’ouvrit toutes grandes les portes de ce rock appelé
à éponger bien des heurts.
Insensiblement, la
musique put ainsi devenir ma religion. En quelque endroit que
j’allais, on peut dire à marche forcée, je portais en bandoulière
ce transistor. La nuit même je l’enfouissais sous le drap pour que
de sa chambre le père n’en perçoive rien. Si l’existence
s’avère vite quelque chose d’inquiétant, en même temps ce sont
ces causes d’inquiétude qui l’obligent comme une rivière les
obstacles au dessin singulier de son cours. Il est peu douteux que
l’on n’ait pas remarqué la proximité des mots “dessin” et
“destin”. À la question qui suis-je ? que j’aurais tendance à
orthographier qu’y suis-je ? il est possible de répondre : je suis
le dessin d’un destin, sa topographie, son silence.

avec Phil May (The Pretty Thongs)
~ 3 ~
Baggio
ça n’a pas marché, du coup me voilà rapatrié en classe de
certificat d’études à l’école primaire pour garçons de la rue
Guillaume Tell. Les écueils participent de ce que nous filons du
mieux que nous pouvons, c’est sur eux que nous rebondissons. Je
peux donc savourer une quiétude scolaire insoupçonnée, des pensées
neuves me viennent, je participe, réalise des projets dont on me
félicite, je m’épanouis. À SLC, “Pour moi la vie va commencer”
fait un carton et pour un peu je reprendrais bien cette chanson à
mon compte. Une rémission ? On verra bien ! Époque des “pétoires”
(Malaguti, Flandria et autre Paloma “Flash” dont l’idole des
jeunes va jusqu’à faire la pub). Les garçons et les filles de mon
âge de cette partie reculée du quartier qu’on appelait alors
“blocs Saint-Sauveur”, les filles surtout en amazone derrière
leurs chevaliers servants, immanquables avec cheveux crêpés et
parfums sortis des distributeurs à tirette. C’est cette bande dans
le vent qui chaque soir pétarade sur ses “terribles engins”,
bande qu’on ne manquera pas de remarquer sur les autos tamponneuses
quand la ducasse prendra possession de la placette devant l’église
Saint-Charles. Mais bande ou pas bande, c’est encore le travail qui
rythme la vie, et là le secteur est calme. Les autres jeunes du
quartier ne forment pas de bandes, roulent en randonneur ou en
demi-course et rentrent chez eux avant la tombée de la nuit.
Finalement, le plus poor lonesome teddy boy du quartier c’était
peut-être bien moi qui avec mon inséparable transistor avais déjà
entrepris d’être à moi-même ma propre bande.
Passablement
excentré, le quartier des Bois Blancs que ceignent deux bras de la
Deûle est presque une île, en tout cas un village qu’animait une
foultitude de petits commerces, une activité paroissiale
plébiscitée, deux cinoches incontournables : le “Bois Blancs”
où s’apparentent les jeunes du groupe scolaire Guynemer/Hélène
Boucher (les fameux “blocs”) et le “Mirage” du côté du
groupe scolaire Alfred de Musset/Desbordes-Valmore. Je fais un peu de
géographie, n’est-ce pas ! C’est une habitude de la maison, dès
qu’on discute musique on fait de la géographie. Ajoutons le vaste
terrain vague qu’on appelle “le petit bois”. Possible que les
arbres fruitiers qui s’évertuaient à évoquer un passé sur
lequel personne ne s’interrogea jamais y fussent pour quelque
chose. Au p’tit bois on croisait des enfants qui allaient à
l’marotte à poires, des promeneurs que leur chien baladait, des
amoureux qui flirtaient, des vagabonds. Aucun jardin public ne
rivalisait avec ce petit bois où fouler l’herbe haute était la
matière même du rêve.
Tout
ça pour toucher un mot au sujet des deux cinoches du quartier. Ah,
l’âge des cinoches ! Et ce n’est pas Eddy Mitchell qui me
contredira ! La vie de famille était tumultueuse mais pour ce qui
est d’aller au cinéma nous y allâmes copieusement. Même que s’il
avait pu m’arriver d’y aller seul, de temps en temps, j’aurais
pu m’asseoir auprès de Josette. Mais le cinéma était le pendant
de la messe du jeudi matin : non, non, non tu ne t’approches pas
des filles, trop dangereux ! C’est ainsi qu’invariablement le
père était satisfait de la programmation des cinoches. Qu’en vain
mon cœur battît à tout rompre, en a t-il jamais eu cure ? Au “Bois
Blancs” j’ai vu quelques films avec Elvis Presley : “Bagarres
au King Créole” de Michael Curtiz, “Viva Las Vegas”, “G.I.
Blues”, “Love me tender”, “Fun in Acapulco” et bien entendu
l’incontournable “Rock du bagne” ; exception faite de ce film,
c’est peu dire que le King qui a tourné dans une bonne trentaine
de films n’a pas laissé une image notoire d’acteur. Également
le second film dans lequel apparaît Johnny Hallyday : “D’où
viens-tu Johnny ?”, le premier avec les Beatles : “A hard day’s
night” et aussi dans un autre registre “Paris-Champagne” qu’en
toute candeur je voyais érotique. Le samedi soir, les Dracula,
Frankenstein, vampires et autres loups garous pullulaient, mais de
cela il était dit qu’il ne serait jamais question. D’ailleurs
quel besoin d’aller se faire des frayeurs avec Peter Cushing quand
le lendemain au “Mirage” passait un Maciste avec Steve Reeves ou
un Zorro avec Tyrone Power ? Reste que le goût pour le cinéma que
cette irrévocable sujétion m’inculqua n’est pas exempt de tout
arrière-goût.
J’eus
le CEP haut la main, ce qui me valut de n’être récompensé ni
d’une Mobylette ni du traditionnel randonneur bien trop dangereux !
C’est sur l’électrophone que mon père se rabattit et au fond ce
n’était pas la pire des options puisque cinquante-cinq ans plus
tard, l’âme de ma discothèque vibrionne toujours. C’est à
partir du Big Bang qu’il occasionna que je suis passé d’une
préhistoire inespérée à la véritable histoire du rock.
avec Arthur Brown
~ 4 ~
Cet
électrophone, un Philips, mon père et moi allâmes l’acheter au
petit magasin d’électroménager qui faisait l’angle de la rue du
Marais de Lomme et de la rue Descartes, je nous y vois encore. La
boîte dans laquelle le commerçant m’invita à choisir un disque
qu’il m’offrait ne recélait que des supers 45 tours de
rock’n’roll. C’est Little Richard qui rompit l’embarras du
choix — “Good golly miss Molly”. Concis, ferme et définitif.
J’ai écouté et écoute toujours le Little Richard de cette
époque, j’en retire à chaque fois la certitude que si le
rock’n’roll n’était pas advenu il aurait manqué quelque chose
au monde, il aurait manqué un morceau de monde. En ce sens, il y a
du philosophique dans le rock’n’roll. Toute cette énergie...
Cette espèce de cri de guerre introductif de “Tutti frutti” :
“A-wop-bom-a-loo-mop-a-lomp-bom-bom” n’est-il pas inaugural ?
Dans quel genre musical autre que le rock’n’roll ce hurlement
eût-il été possible ? Il fallait être un peu fou, c’est
d’ailleurs ce qu’il dit de lui-même : “Mes parents écoutaient
Bing Crosby et Ella Fitzgerald. Je savais qu’il devait y avoir dans
la musique quelqu’un de plus cinglé que ça. J’ai découvert que
c’était moi !”. C’est une déclaration que je rapproche de
celle que Nikos Kazantzaki fait dire à Alexis Zorba : “... tu n’es
pas libre. La corde avec laquelle tu es attaché est un peu plus
longue que celle des autres. C’est tout. Toi, patron, tu as une
longue ficelle, tu vas, tu viens, tu crois que tu es libre, mais la
ficelle tu ne la coupes pas. Et quand on ne coupe pas la ficelle...
(...) C’est difficile, patron, très difficile. Pour ça il faut un
brin de folie ; de folie, tu entends ?”. Surplomber l’autre côté,
excéder ses limites en se retenant de basculer, effectivement
l’exercice est périlleux. Tous n’y arrivent pas, ou n’y
arrivent que pour mieux dégringoler. Mais les Little Richard, Chuck
Berry, Jerry Lee Lewis y sont parvenus.
De
tous ceux qu’on a coutume d’appeler les pionniers du rock je ne
saurais dire qui est le meilleur, qui est le moins bon. À quatorze
ans j’avais une préférence pour Eddie Cochran parce qu’il
fallait bien que je me choisisse un héros, ou un “héraut”,
l’homophonie fait sens (pas une idole), mais deux minutes après je
me disais que Gegene était tellement bon, et Buddy Holly, et Fats
Domino, Fats Domino qui se produisit au Sébasto, pour ne rien dire
du King. King au sujet duquel Little Richard disait d’ailleurs :
“Pour nous les Noirs, il a été une bénédiction”. De l’un à
l’autre il y a des variations mais le peloton est d’une telle
compacité qu’il exhausse à jamais la décennie. J’ai jadis eu
un échange épistolaire contradictoire sur le sujet avec un type de
ma génération qui tenait un fanzine, le rock pour lui n’avait de
légitimité que noir. Il n’avait d’oreille que pour le
rhythm’n’blues des années 40 et 50 et je ne jurerais pas que
celui des 60’s ne lui apparaissait pas comme un compromis avec
l’adversité. Tout ce qui blanc de peau prit naissance avec Elvis
Presley n’était pour lui que plagiat et falsification. C’était
faire fi du fait que si la musique est une matière essentiellement
impure c’est pour que les musiciens se fassent alchimistes.
Il
était dans l’ordre des choses qu’après l’EP de Little Richard
s’ensuivît la discothèque. C’est avec mes petits sous que les
bureaux de tabac et marchands de journaux qui vendaient des 45 tours
d’occasion inaugurèrent le type du dépensier économe. Pour ce
qui est du 33 tours, il y avait l’Eden, rue de Paris, mais le 33
tours ne s’appliquait pas encore au format du rock’n’roll dont
les supports de prédilection étaient le jukebox et le Teppaz, et
puis le 33 tours coûtait les yeux de la tête. C’est dans ce
contexte que mon ami Ahmed Toumi dégota l’exception qui confirme
la règle en m’offrant pour mon anniversaire “Good Rockin’
Tonight”, le 33 tours 25 cm d’Elvis Presley qui venait juste de
sortir.
avec Pete Brown
~ 5 ~
Fraîchement
débarqué d’El Milia pour rejoindre son grand frère qui
travaillait en filature à Lomme, Ahmed, plus exactement Boudjemaa,
était mon aîné d’un an. En attendant l’âge légal de seize
ans pour aller travailler avec lui à l’usine, il fut scolarisé
pour l’année dans la même classe de CEP que celle où j’avais
atterri. Parlant le français avec difficulté, il tâchait tant bien
que mal de faire son miel de ce que Mr Payelle, le directeur, lui
enseignait entre histoire et géographie, et surtout de ravaler la
colère de la bête curieuse à quoi les idiots le contraignaient.
C’est quand l’heure de la récréation venait qu’insultes et
provocations lui tombaient dessus. Certains élèves, Jojo le moins
finaud notamment, prenaient plaisir à le pousser à bout jusqu’à
ce qu’il se rebiffe, l’attroupement que cela occasionnait alors
faisait accourir directeur et instituteurs et c’est lui qui écopait
des baffes. Cette injustice a toujours obscurci l’image idyllique
que j’avais de cette école et je n’excuse pas cet estimable
directeur de s’être abstenu de chercher le pourquoi du comment.
Ahmed
vivait avec une communauté maghrébine dans une des deux immondes
courées aujourd’hui disparues de l’avenue Marx Dormoy. Celle des
maisons dans laquelle il créchait, ou plutôt ce qu’il en restait,
n’avait pour tout meuble qu’un Butagaz, une vieille table,
quelques chaises branlantes et un ou deux grabats sur des journaux.
Chiottes et robinet dans la cour où je le vois encore se laver les
pieds en dépit du froid. L’année scolaire terminée, nous avons
continué à nous fréquenter malgré qu’il fût hors de question
qu’il franchît le seuil de notre maison. Non que mon père fût
expressément raciste mais quand bien même il ne l’aurait pas été,
personne hormis le charbonnier pour livrer le charbon n’est jamais
entré chez nous. Chacun chez soi, c’était comme ça... C’est
peu dire que les familles ouvrières des Bois Blancs ne lésinaient
pas sur cette rudesse de mœurs qui leur tenait lieu de rectitude.
Sans vouloir jeter l’opprobre, dans combien de maisons entendait-on
les disputes quand on passait rue de La Bruyère ? De retour de
mon service militaire Ahmed était reparti en Algérie et je n’ai
plus eu de nouvelles de lui.
Par
quelle intercession très volatile mes pensées se tournent-elles si
souvent vers l’Algérie ? Celle d’Ahmed ? Celles de
Tayeb, Houcine, Djelloul, Belkacem, Allaoua et de tant d’autres que
nous connûmes et qui pour tout bagage n’avaient que leur
humanité ? Que font-ils aujourd’hui ? Sont-ils même
encore de ce monde ? Jeune enfant, je ne savais rien de la
guerre dite d’Algérie mais je me souviens avoir vu par la fenêtre
du 3ème étage où nous habitions les gardes mobiles ratonner les
manifestants à l’angle des rues Gambetta et Solférino. Cette
vision se confond avec ce que mon père me disait des Allemands
tirant en direction des fenêtres de cette même rue Solférino quand
ils quittèrent Lille à la Libération. L’Algérie est une vieille
résonance pour moi qui la connaît si peu. Aux méthodiques qui
m’objecteraient qu’ils ne voient pas le rapport avec la véritable
histoire annoncée, je dirais que c’est parce que cette histoire
est une autre histoire qu’elle est véritable, et qu’ils ne sont
pas au bout de leurs peines. C’est aussi parce que le rock fut plus
qu’un phénomène musical stricto sensu, que des transformations
comportementales et politiques, résultant notamment du conflit
générationnel débordèrent de toutes parts la chose distractive
que la musique avait été pour les générations précédentes.
Posture + électricité, un vecteur.

avec Kevin Coyne
~ 6 ~
Avec
l’entrée de plein pied dans l’adolescence toutes sortes de
litiges entreprirent d’enfoncer ce clou dont on serait tenté de
penser qu’il est le propre de leur nature tant qu’il n’a pas
été enlevé du pied. De deux choses l’une, ou le problème c’est
le clou ou c’est le pied, sachant que leur rencontre sur la table
de dissection est loin d’être fortuite. Adieu donc école Alfred
de Musset, odeurs de craie et de poêle à charbon, robinets qui
fuyaient et Alésia, Poitiers, Marignan comme larrons en foire ! Au
collège qui lui succéda, l’École Professionnelle des Industries
Lilloises, je rendis ma place au mortel ennui : dernier de classe
dans toutes les matières. Conspirationniste, je dirais que les
lanternes rouges ont les mêmes astreintes que les têtes d’œufs
afin d’être mis sur la touche. Est-ce pour dissimuler le soleil
que les institutions catholiques ont de si infranchissables façades
? Même les cours de dessin me faisaient froid dans le dos. Dans
cette caserne où j’ai croupi pendant deux ans la seule compétence
qu’on m’accorda consista à donner le ton des cantiques à la
messe hebdomadaire. Caserne pour caserne, cantique pour cantique,
c’est encore à moi qu’échoirait de donner le ton au service
militaire. À la même époque, pour pallier les cours de piano en
pure perte chez Schillio puis l’apprentissage du solfège en pure
perte en mairie de Lille je me retrouvai à apprendre, toujours en
vain, solfège et saxo trois ans durant en mairie de Lomme, après
quoi, de guerre lasse, je raccrochai pour quelque temps.
Avec les 60’s, la
métamorphose du pouvoir d’achat changea la donne, la citrouille se
changea en clinquantes “4 CV Renault” ou “2 CV Citroën”, la
bicyclette se fit “Mobylette”, leur firent cortège la machine à
laver avec essoreuse à rouleaux, le robot marie “Moulinex”, la
cuisine en formica pour laquelle il fallut faire place nette, la télé
et avec la télé le temps de la télé dévolu à sa substantifique
transcendance. Si pour ne pas subir “Au Théâtre ce soir” que je
pris en aversion je m’éclipsais dans ma chambre, il me fallait
auparavant essuyer la volée de bois vert incluse dans la cérémonie
en cas de défection. Par contre si je suggérais un film qui par
quelle obscure intuition venait de capter mon attention, il se
pouvait que le père changeât de chaîne ou tout simplement décrétât
l’heure d’aller au lit. Ce fut le cas de “L’Île nue” de
Kaneto Shindō au bout d’une demi-heure. Tant pis, les heures de
gloire de Steve Reeves et de Mark Forrest étaient comptées, dans
quelques années je me rattraperais au cinéma, entre amis pour plus
de sûreté, avec “Théorème” de Pasolini. Au demeurant,
patience et longueur de temps faisant plus que force ni que rage,
tout venant à point à qui sait attendre, etc., je vis la suite de
“L’Île nue” en VHS une trentaine d’années plus tard. Jésus
avait marché sur les eaux, mais c’est le dieu Progrès qui
marchant sur la tête raflait maintenant le plébiscite.
Sur le versant tout
aussi distractif de la musique, les modes incitaient à ce que l’on
changeât de disque comme de chemise. Du rock’n’roll pur jus des
50’s que j’écoutais hier encore, une option soft redevable aux
Paul Anka, Elvis Presley, Brenda Lee ou Buddy Holly se mit à
stimuler le romantisme des Roy Orbison, Everly Brothers, Dion, Del
Shannon, Bobby Darin, Neil Sedaka : ce qui n’allait pas tarder à
s’appeler pop music. Quant à la musique noire elle explosait
littéralement : centaines de hits qui du doo-wop au rhythm’n’blues
que signaient Atlantic, Stax ou Tamla Motown se vendirent comme des
petits pains pour la gloire des Aretha Franklin, Ray Charles, James
Brown, Otis Redding, Little Stevie Wonder et tant d’autres. Puis ce
fut au tour de la Grande Bretagne de s’éveiller. Impact planétaire
! Dans le sillage des Beatles qui avec “Rubber soul” venaient
d’injecter de l’inédit, les Rolling Stones provoquèrent avec
“Satisfaction” la déflagration que l’on sait, leur firent
suite les Who, Kinks, Animals, Pretty Things, Yardbirds, Them et pour
le romantisme, les mélodies et harmonies vocales des Herman’s
Hermits, Fortunes, Hollies, Searchers, Manfred Mann, Zombies, etc.
Moins tonitruant mais également moins mineur qu’il pourrait
sembler, un certain éclectisme de la nouvelle vague hexagonale ne
s’avoua pas en reste. Et tout ça ne faisait que commencer. Ce sur
quoi, je me détachai de ce qui était devenu yéyé. Ma véritable
histoire du rock pouvait longer le fort bel alignement de noms
propres de l’histoire du rock proprement dite, en toile de fond
“The times they are a-changin’” nous rendait à nous-mêmes.

avec Dana Gillespie
~ 7 ~
Feuilletant
le riche album photo de mes tendres années : autant mon paternel
avait vu rouge suite à cet achat de boots Chelsea, autant le blouson
bombardier pour l’achat duquel il n’émit aucune objection,
lui-même s’en était procuré un, n’enfreignait pas la
respectabilité de l’image de soi à laquelle on aurait pu
s’attendre de sa part. Peut-être mon père jugeait-il ce blouson
suffisamment prolétaire pour n’y trouver rien à redire. Si la
protection qu’offre le bombardier contre le froid est à l’avenant
de son prix élevé, et au petit matin sur son cyclomoteur il lui
fallait bien ça, de mon point de vue c’était surtout le vêtement
des blousons noirs. Les distingués élèves du collège Saint
Jean-Baptiste de la Salle où l’on m’expédia après l’EPIL ne
s’y trompaient d’ailleurs pas qui me gratifiaient de leurs
remarques acerbes. Trop fier de ne pas être des leurs je m’en
fichais bien.
Non moins paradoxale
la permission de fumer, pour ne pas dire l’encouragement culturel,
conférée par l’obtention du CEP. Auparavant était déjà acquis
que je pusse de temps en temps m’acheter des cigarettes à
l’eucalyptus à la pharmacie, là je disposais du blanc-seing
autorisant la Gauloise, il faut savoir que dans les 60’s, la Gauldo
n’était pas cause de cancer ! Je prends la balle au bond pour
confier à propos de la classe ouvrière dont elle était l’égérie
ce que Sacha Guitry disait des femmes : “je suis contre, tout
contre”. Il n’y a d’ailleurs pas qu’au sujet de la classe
ouvrière que je puis emprunter au grand auteur. Tant de choses ne
valent d’être aimées qu’au prix d’accents discordants. Le
rock en est une, fermons l’aparté.
Sur une photo datée
de Noël 1964, je tiens en éventail des disques de Danny Boy, Hugues
Aufray, les Shadows et Johnny Hallyday. Sur une seconde du 28 octobre
1965, je tiens le 45 tours “Like a rollingstone” de Bob Dylan.
Sur une troisième de juin 1966 je tiens un super 45 tours de Chris
(Long Chris) avec le très dylanesque “Plan de fugue”. Sur une
quatrième enfin, de 66 également, le super 45 tours des Yardbirds
avec “Still I’m sad”, “Evil hearted you”, “I’m a man”
et “I’m not talking”, Yardbirds qui avec ce disque devinrent
sur le champ mon groupe d’élection. Je n’ai pas souvenir d’un
groupe, surtout à l’époque où Jeff Beck y officiait, se
coltinant le son avec une telle attaque. Dans quelque discipline que
ce soit, se pose toujours la question “est-ce qu’il se passe
quelque chose ?”. Avec les Yardbirds, ce qu’il se passait tenait
à Jeff Beck qui était un guitariste qui savait tordre le cou de
l’éloquence, le contraire d’Eric Clapton qui ne commença à
m’épater qu’à partir de sa participation aux Bluesbreakers de
John Mayall. Là où Clapton voulait jouer le blues comme avant lui
B. B. King, Jeff Beck jouait comme Jeff Beck. À sa suite, Jimmy Page
n’oublia pas de jouer comme Jimmy Page au contraire du successeur
d’Eric Clapton au sein des Bluesbreakers, Peter Green, qui y joua
le blues à la façon d’Eric Clapton. Mais ça ne durait pas, tout
le monde finissait par trouver sa voie, Eric Clapton avec Cream,
Peter Green avec Fleetwood Mac, Jimmy Page avec les New Yardbirds,
John Mayall avec Mick Taylor entreprenant le blues comme Peter
Green... Du côté de nos seize ans, c’est de toutes ces choses-là
dont nous discutions pendant des heures, et c’était passionnant.
À cette époque je
n’en mourais pas moins d’un fébrile ennui. Je ne m’appesantirai
pas sur le tohu-bohu des causes, l’adolescence est une telle
prédisposition à ça — et puis j’étais loin d’être le seul
— l’envie de rompre les amarres couvait. Lille ! Lille suintant
les fumées hivernales crachées par les poêles à charbon, Lille
qui avait déjà amorcé son déclin industriel et entamé une
précarisation du travail que l’aura des trente glorieuses n’effaça
pas. École, appareil idéologique d’État ! Famille, appareil
idéologique d’État !... Jusqu’au jour de mai 1967 où Michel
Drucker nous fit découvrir Jimi Hendrix à la télévision. L’ennui
contré par l’inouï ! Archange ou Martien, le coup au cœur eût
été identique s’il était descendu de tout là-haut en soucoupe
volante. Jouer de la guitare avec les dents, ni chez les Zoulous, ni
chez les Papous, ni chez les Mandchous, ça ne s’était jamais
fait. Dans la classe, le lendemain, nous étions trois ou quatre à
jubiler, pour ma part j’avais l’impression qu’il nous vengeait
de toute cette noirceur, les autres n’avaient que propos infamants
à son égard. La récession qui ronge la foi occidentale a gommé
qu’il faut un zéro dans le dos pour viser l’infini. De par son
caractère de totalité le plein aussi annule la plénitude, mais ce
n’est pas le même vide.

avec Spooky Tooth
~ 8 ~
Eh bien voilà,
l’école est finie ! Une page se tourne, nous sommes en septembre
1967, j’entre pour deux ans comme dactylo-facturier à la Cie
lilloise des vins et alcools que tiennent trois membres de la famille
Dambrine : Louis, le boss, un vieil acariâtre sourd comme un pot
dont les mouchoirs sèchent sur tous les radiateurs, le très zélé
Léon et un discret cadet. C’est pour avoir gobé un mauvais deal
où apparaissait que mes capacités inclinaient davantage pour
l’École des Beaux-Arts que pour le technique ou le commercial que
je me retrouve dans un bureau minable avec des employés foldingues.
Salaire mensuel de départ : 350 francs (environ 434 €). Dans le
bureau Marie-Claude, ma supérieure d’un an mon aînée dont la
minijupe est rituellement reluquée par le salace chef d’atelier.
Dans son coin, le fumeur de pipe qui s’occupe des livres de régie
s’appelle aussi Léon. Raymonde, une vieille dame unijambiste ne
sert pas à grand-chose mais qu’un opportun brin de causette ne
manque pas d’encourager. Dans le bureau contigu, Gilberte qui ne
répugne jamais à la grivoiserie. Également Louis C., un ancien
rexiste et une jeune secrétaire de la maison associée Choteau qui
se plaît à venir s’asseoir sur ses genoux. Monsieur Casterman, le
directeur, et sa fille qui le week-end tient le night-club Bachy
Station. Une jeune Gertrude tout de bleu
marine vêtue comme les filles du Lycée Fénelon. Jean-Pierre, un
garçon de mon âge qui la journée finie met à contribution sa
myopie dans la fréquentation assidue des pissotières de la
Grand-Place. À l’étage les “deux vieilles” de la
comptabilité, Andréa et Augusta sa subordonnée, ennemies jurées
de l’ancien rexiste. C’est à cet étage aux carreaux cassés que
le froid poussa mon service vers la sortie. Cet hiver 1968-69, j’y
tenais des comptes sur une machine comptable délabrée avec des
gants en laine.
Tout
ce monde-là était pitoyable et drôle, et moi je planais, mon
travail était très loin d’être efficient. Si j’avais eu le
goût pour l’écriture j’aurais pu puiser la matière d’un
roman bien déjanté, mais tel n’était pas encore le cas. Je
planais et à la réflexion planer était l’exact moindre mal, ça
laissait au brouillard le temps de se dissiper, la latitude de voir
venir. Ce qui jusqu’à présent retenait mon attention, on l’a
compris, c’est le rock. Comme pour pas mal de teenagers des
faubourgs c’est, j’imagine, ce qui me tenait la tête hors de
l’eau. Ce n’est pas donner dans un excès d’enthousiasme que de
faire état de sa luxuriante polysémie : artistique, culturel,
social, politique, et si la société de consommation participait de
son devenir c’est dans la mesure des anticorps qu’elle généra.
C’est peu dire ici que le rock était un bon indicateur, à la fois
laboratoire et centre de production ; cette seconde moitié des
sixties fut sa zone de turbulence par excellence et 1968 son
épicentre.
Maintenant que
j’étais salarié, le droit de sortir en boîte m’était
accordé... le dimanche après-midi jusqu’en début de soirée, mon
argent de poche, le fameux “dimanche”, étant proportionnel au
salaire que je rapportais. Je n’allais pas bien loin avec ça mais
au moins y allais-je en Mobylette, une Mobylette abandonnée que mon
père avait réglementairement gardée en dépôt et qu’il me donna
au bout d’un an. Cette boîte, point de chute de toute la jeunesse
métropolitaine de mon âge, s’appelait l’Alvarez, plus
exactement Cavern’ du Rythm-Club Alvarez, sise à côté des Bains
lillois, boulevard de la Liberté. Y passaient des groupes qui
étaient des tribute bands avant l’heure. Les Five Beats jouaient
le répertoire des Yardbirds, les Extrems Jimi Hendrix, les Wags les
Who, les Things avec l’ami Alberto à la guitare avaient un
répertoire rhythm’n’blues, Yannick Dooghe leur chanteur les
quitta pour rejoindre Think Now au répertoire pop-rock, plus tard
Think Now, tel Janus, se dédoubla en Bérénice avec Bernard
Lernoult alias Dave au chant. Quant aux Yells dont le guitariste solo
Éric Dumez avait été élève dans la même classe de seconde que
moi, leur répertoire reprenait VIPs, Kinks, Spencer Davis Group. Il
ne manquait à ces groupes que de s’attaquer à la composition pour
s’offrir l’originalité qui aurait fait la différence, mais
cette chose si évidente n’était pas encore dans l’air du temps.
Quand, sous l’impulsion de groupes comme les Variations ou Martin
Circus première mouture le temps des adaptations se mit à passer de
mode, ce dut être subitement trop tard pour nombre d’entre eux,
c’est ainsi qu’aucun ne se professionnalisa hormis le second
guitariste des Five Beats qu’on retrouva dans l’éphémère
Anarchic System.

avec The Zombies
~ 9 ~
Dérogeant
à mon habitude de n’acheter que des disques d’occasion, c’est
le cœur battant que ce jour-là je repartis de l’Eden, le
disquaire de la rue de Paris, avec les supers 45 tours des Doors et
de John Mayall’s Bluesbreakers (avec Eric Clapton) que je n’avais
pu me retenir de commander. “Break on through” et “Key to love”
étaient dans leur registre respectif des morceaux comme on n’en
avait jamais entendus, au sens propre du terme ils étaient inouïs.
Cependant ils n’étaient pas les seuls à sortir du lot :
“East-West” du Paul Butterfield blues band, “2000 lights years
from home” des Rolling Stones, “Lucy in the sky with diamonds”
des Beatles, “Eight miles high” des Birds, “Hole in my shoe”
et “Paper sun” de Traffic, “White room” ou “Sunshine of
your love” de Cream, “Burning of the midnight lamp” ou “Bold
as love” du Jimi Hendrix Experience, et tant d’autres étaient
immergés dans une phase d’innovation sans précédent. John Mayall
n’était pas le premier anglais à jouer le blues en Angleterre
mais c’est à partir de lui et de ses Bluesbreakers, Bluesbreakers
qu’il renouvela continuellement, que l’Angleterre se dota d’une
génération de bluesmen telle qu’elle dut surprendre bien des
vétérans outre-Atlantique. Très vite il s’en trouva, Champion
Jack Dupree, Howlin’ Wolf, Freddie King, etc., pour venir jouer
avec ces enfants prodiges. C’était d’autant plus intéressant
que cette jeune génération d’une parfaite originalité contribua
à nous ouvrir toutes grandes les portes du blues américain que nous
ne fréquentions pas tous, tandis que de son côté le “Shake it
baby” de John Lee Hooker ouvrait celles de nos discothèques, entre
Johnny Rivers et Canned Heat. À partir de ce moment-là, le blues
commença à essaimer sur la terre entière où bien des
particularismes se mirent à en enrichir et l’esprit et les formes.
Rien de cela n’avait à voir avec de la déco,
c’était tellement excitant que tous autant que nous étions nous
crevions d’envie de mettre la main à la pâte d’une façon ou
d’une autre.
Mes
précédents déboires au piano et au saxophone ne m’ayant pas
dissuadé d’apprendre à jouer d’un instrument, j’entrepris
alors de prendre des cours de guitare à l’U.F.J. avec ma
vieille Egmont Lucky 7 dont la concavité du manche se voyait
pourtant comme le nez au milieu de la figure, et pas de truss-rod
pour le rectifier : Egmont n’est pas Gibson. L’U.F.J. c’était
formidable, c’était gratuit, mais le rapport courbure du
manche/trentaine d’élèves que nous étions dans la classe finit
par avoir raison de ma bonhommie. Au bout d’un an, je fis cadeau de
mon Egmont à mon ami Francis et, négligeant le fait qu’il faut au
minimum disposer de l’instrument que l’on convoite pour apprendre
à en jouer, m’inscrivis au Conservatoire de Lille afin de passer à
la contrebasse. N’ayant évidemment pas d’argent pour m’en
offrir une, l’apprentissage s’interrompit de lui-même au bout de
trois mois.
S’il n’était
pas rare de me trouver flanqué au Printemps ou aux Nouvelles
Galeries pour regarder “Bouton rouge”, sur la 2e chaîne depuis
avril 1967, ce n’était pas par dépit de n’avoir pu jusqu’alors
me débrouiller avec un instrument de musique, seulement qu’avoir
la possibilité de regarder ce magazine à la maison était devenu
difficilement négociable. Retirai-je de cet état de fait la rage
qui est le fond limoneux du rock’n’roll ? Ou alors celle que l’on
dit de son chien quand on veut l’abattre ? C’est vrai que ça ne
marchait pas bien, et même pas du tout. En vertu de quelle
projection choisit-on de procréer ? Au nom de quel projet
décide-t-on d’éduquer ses mômes plutôt comme ci que comme ça ?
Apprendront-ils bien leurs leçons ? Seront-ils de bons salariés ?
Feront-ils seulement ce qu’ils pourront ? Toutes questions pipées
au sujet desquelles père et mère, au fil du temps, avaient fini par
convenir qu’ils ne s’accorderaient jamais, consommant de
préférence leur antagonisme comme Mithridate ses doses journalières
de ciguë. Je ne me souviens pas de la couleur de ma colère. Noire
comme l’œil au beurre noir dont l’un de nous deux écopa —
mais qui ? — le jour où je m’interposai entre ma mère et mon
père, ou rouge comme celle qui lui prit quand je lui dis que j’avais
l’intention d’adhérer au communisme ? Ni incolore, ni inodore :
rentrée. Entre mémoire appliquée au devoir et droit à l’oubli,
quelle correspondance serait dupe ? Ironie du sort, quelque temps
plus tard ma mère sans doute affligée de mon infortune m’offrit
une guitare classique, une Morena, dont je m’empressai de remplacer
les cordes en nylon par des cordes en acier. Quoique la table
d’harmonie se soit un peu prêtée à la tension des cordes,
quarante ans plus tard et quelques migrations pas toujours
précautionneuses le manche de la vieille gratte n’a pas succombé
au sacrilège.

avec Peter Coyne (The Godfathers)
~ 10 ~
Nous
voilà en 68. En ce temps-là un se divisait en deux, d’un côté
le rock (pop rock, pop music, sous ma plume ces noms permutent), de
l’autre la musique « commerciale » comme on disait alors. Claude
François pouvait bien reprendre Lamont Dozier ou les Four Tops,
c’était commercial, tandis que Ronnie Bird reprenant les Who ou
les Troggs, c’était rock. En réalité, que Claude François alias
Cloclo reprît des standards de la soul music et Ronnie Bird ceux de
pop anglaise était a priori d’autant moins clivant que dans son
art de l’appropriation le premier n’était pas à une reprise
près des Beatles ou de Creedence Clearwater Revival, ni que l’un
comme l’autre aient eu une coupe de cheveux que Carnaby street
n’eût pas désavouée. Quoi alors ? Notre désaveu du premier et
notre écoute accordée au second tenaient à un tas de détails où
toute objectivité, estimions-nous, était loin d’être exclue.
Cinquante ans plus tard je ne me rétracte pas : business d’un
côté, dandysme de l’autre, même si je trouve aujourd’hui
qu’avec l’exclusivité accordée aux reprises, Ronnie Bird et
Noël Deschamps n’ont pas dérogé aux complaisances d’alors et
en fin de compte pas fait mieux que les autres. L’époque était
aux Golf Drouot, Locomotive, Bus Paladium et à une idée du nirvâna
décidément exotique, difficile en ce cas d’être sinon voyant du
moins clairvoyant. 68 c’est mai, mais ce n’est pas que mai. Pour
ma part ce ne fut pas mai. Primo parce que je n’étais pas
étudiant, secundo parce que la Cie Lilloise des Vins et Alcools
était trop excentrée pour que parvienne le bruit de fond, tertio
parce que je n’avais aucune conscience politique. Pourtant le 11
mai je me souviens parfaitement avoir regardé passer la manif rue
Nationale (30 000 manifestants selon “La Voix du Nord”, 50 000
selon “Liberté”), des manifs de ce calibre-là on n’en fait
plus. Surtout, j’avais des préoccupations bien plus urgentes.
Venant en effet de quitter la maison familiale, je m’étais
installé dans une piaule place du Lion d’Or, une glacière, qui
dégrevait de moitié mon maigre salaire, ce qui supporta d’autant
moins l’indépendance escomptée qu’au bout d’un trimestre,
mortifié, je réintégrai le bercail.
Si
un se divise en deux, cela signifie-t-il qu’inversement deux se
rassemble en un ? De nos jours bien des cheveux se sont coupés en
quatre, mais à l’époque s’il arrivait à la poire de présenter
deux moitiés (mods/rockers, pop music/soul music, pop française/rock
anglo-saxon, etc.), la tendance était plutôt au croisement des
genres, l’atteste l’affiche du festival d’Amougies, l’année
suivante. Vend. 24 oct. : Ten Years After, Colosseum, Aynsley Dunbar
Retaliation, Alan Jack Civilization, Art Ensemble of Chicago, Sunny
Murray, Burton Greene, 360 Degree Music Experience, Free Music Group.
Sam. 25 : Pink Floyd, Freedom, Keith Relf’s Renaissance, Alexis
Korner & the New Church, Blues Convention, Grachan Moncur III,
Arthur Jones, Joachim Kuhn, Don Cherry. Dim. 26 : Martin Circus, Alan
Jack Civilization, Triangle, We Free, Cruciferus, Indescriptible
Chaos Rampant, Nice, Caravan, Blossom Toes, Ame Son, Archie Shipp,
Kenneth Terroade, Anthony Braxton, Germ (Pierre Mariétan). Lun. 27 :
Yes, The Pretty Things, Chicken Shack, Sam Apple Pie, Frogeaters,
David Allen Group, Keith Tippett Group, Pharoah Sanders, Dave
Burrell, John Surman, Clifford Thornton, Sonny Sharrock, Acting Trio.
Mar. 28 : Soft Machine, Captain Beefheart, East of Eden, Fat
Mattress, Zoo, Alan Silva, Robin Kenyatta, Chris McGregor, Steve
Lacey, Dave Burrell Gig Band, Musica Electronica. Il me reste de
l’affiche de ce festival auquel mon escarcelle plate comme une
limande ne me permit pas d’assister — jamais Lille ne me parut
aussi vide que ce week-end-là ! —, que de tous (Monterey,
Woodstock, île de Wight, etc.) ce fut lui le plus signifiant : rock,
rock français, jazz, blues, musique contemporaine et même poésie,
tout y était.
Aujourd’hui
que le tribute rock s’est substitué au rock, que dire de ce que
Ronnie Bird, interviewé par Jacques Barsamian, déclarait en avril
68 : “Je regrette que le marché français ne soit pas assez large.
On a tendance à mettre de côté les petites vedettes. Il n’y a
pas de public en France pour les artistes qui font bien leur métier
mais qui ne sont pas des idoles. Le public a besoin chez nous de
choses qui sortent de l’ordinaire, et pourtant, si je voulais être
un John Mayall, ici, je ne travaillerais pratiquement pas” ?
D’abord que si John Mayall avait travaillé en France, il n’est
pas dit qu’il aurait cessé de faire la musique qu’il faisait en
Angleterre. John Mayall était un artiste, non une “petite
vedette”, pour reprendre le terme de Ronnie Bird qu’à l’époque
j’appréciais énormément, seulement voilà... Les artistes, en
France, c’étaient Françoise Hardy, Jack Dutronc qui venu du
groupe El Toro et les Cyclones réussit sa conversion, Nino Ferrer
venu des Dixie Cats, les très indépendants Antoine et Évariste,
l’incontournable Serge Gainsbourg et bien sûr Michel Polnareff.
Les faits sont là, aucun de ceux qui n’ont pas franchi le Rubicon
anglo-saxon, les Noël Deschamps, Larry Greco, Vic Laurens, Erik
Saint-Laurent, Thierry Vincent, etc. n’a fait date.

avec Barrie Masters (Eddy and the Hot Rods)
~ 11 ~
1968,
ce fut août : août 68. Le 1er de ce mois-là, titulaire du diplôme
de moniteur qui en 1973 s’appellera BAFA, je débarquai de
l’autocar dans la colonie de Wormhout où huit ans auparavant
j’avais été colon. Le numéro de Rock & Folk qui dépassait
de ma poche ne manqua pas d’être remarqué par ceux des moniteurs
qui avaient assisté aux récents évènements politiques, il n’y a
pas de secret. Politique, conflits familiaux, rock ne produisaient
pas les mêmes étincelles mais l’eau-forte dans lequel ils
trempaient était commun, s’ensuivaient les sujets de prédilection
que mes nouveaux amis Jean-Claude M., Philippe S., Michel V., André
F., et moi cultivions hors du travail : un mois de discussions tous
azimuts durant lequel la jovialité et l’enthousiasme qu’ils me
communiquèrent furent véritablement initiatiques. De cet été, me
reviennent les balades heureuses avec les enfants le long des routes
communales, une ou deux escapades, les jours de congés, qui
n’allèrent pas au-delà de Bergues, le bal champêtre qu’on eût
dit sorti d’un film d’André Delvaux, pour tout dire ce mois
d’août ensoleillé, une année ensoleillée même, toute
calamiteuse qu’elle fût par ailleurs. Avec septembre et le retour à l'ordinaire
d’autres amitiés se nouèrent : Francis D., Eugène S.,
Jean-Jacques S. le frère de Philippe, Jean-Pierre M. Je dois à
André F. la lecture d’“Une Saison en enfer” et à Jean-Jacques
S. celle des “Paradis artificiels”, lectures d’autant plus
décisives que l’extraction existentielle était semée d’embûches
!
Avec Philippe S.,
Jean-Pierre M., Jean-Jacques S. et quelques autres, nous projetâmes
d’aller à Anvers en auto-stop à la Toussaint. Anvers c’était
la ville du chanteur de folk song Ferre Grignard, également après
Amsterdam une ville vantée pour la facilité de se procurer du
haschich, haschich qui n’était pas de la drogue au sens insipide
qu’on lui prête aujourd’hui, le haschich c’était, attesté
par Baudelaire, un éventail de parfums, la route des beatniks,
Katmandou, “A Saucerful of secrets” de Pink Floyd que nous
écoutions en boucle, un conte, un rêve de rêve. Mon père à qui
j’avais annoncé notre intention d’excursionner en terre flamande
ne chercha pas à savoir ce que nous allions y faire, il me promit
simplement qu’au retour les flics m’accueilleraient. J’avais
dix-huit ans et, en effet cher vieux Paul Nizan, “je n’aurais
laissé personne dire que c’était le plus bel âge de la vie”.
Le serait-il en 1974, quand la majorité civile serait abaissée à
dix-huit ans ? Dans l’immeuble en construction où nous trouvâmes
refuge pour deux nuits, le paradis élucubré plus frigorifiant que
nature nous engagea, Philippe et moi, à laisser nos amis néophytes
à leur trip. L’odeur du cannabis était délectable mais le froid
insupportable, et puis nous n’avions pas le moindre sou en poche.
Débarrassé de son THC, le cannabis est une mine dont on peut tirer des produits
tels que le pétillant que nous bûmes avec ma mère ou la savonnette
que je rapportai d’une foire-exposition. Faisant contre mauvaise
fortune bon cœur nous optâmes pour la Onze-Lieve-Vrouwekathedraal
(la cathédrale Notre-Dame), une balade mélancolique le long de
l’Escaut, une soirée au “Muze” (le café de Ferre Grignard) où
nous attendîmes nos amis assis par terre sans consommer la moindre
boisson tandis que le jukebox rejouait inlassablement “If you feel
like China breaking” et “White room”. De retour à Lille, R. A.
S., aucun flic en vue, aucun commentaire.
Étant libres de
tout emploi salarié, Daniel P., ex pion à Baggio et ami de Francis,
nous soumit à Eugène et à moi le projet de retaper le théâtre
attenant au restaurant universitaire U1, rue de Valmy. Ce théâtre
qui appartenait au CROUS avait été le Q. G. des étudiants en mai.
Il était à la disposition de qui se sentait de le remettre à neuf
et d’en faire quelque chose. Daniel P. avait deux ouvriers auquel
s’ajouterait Francis pour monter la pièce de théâtre qu’il
avait écrite et que nous avions déjà commencé à répéter. Ah,
oui ! une comédienne qui eût joué nue une partie du spectacle,
c’était un fait qu’après que tout Lille se fût précipité à
l’Opéra pour voir le célèbre Living Theater, on la trouverait !
Aucun spectacle qui se respectait ne pouvait plus se dispenser de
faire intervenir des comédiens nus. Pour ce qui était des locaux,
c’est peu dire que ce théâtre avait vécu, tant de choses qu’il
fallut débarrasser, il dut y en avoir des occupations, des A. G. !
Et pas que des A. G., pour autant que l’on pût en juger au nombre
de petites culottes laissées sur place. Non content d’être
politique, mai 68 avait été libertaire et libertin : doublement
festif, les preuves étaient là. Pour Eugène et moi, ç’avait été
un chantier de six bons mois, et nous l’avions mené à bien. Était
d’ailleurs déjà programmée une lecture du poète et comédien
Jean-Marc Tennberg, l’affiche était prête. À ce moment-là, on
vint nous avertir que les anarchistes s’apprêtaient à venir en
découdre avec nous sous prétexte que nous restaurions la culture
bourgeoise. Pas moins ! Était-ce à prendre au sérieux ? Dans
quelques années La Joie de lire, la librairie de François Maspero,
accusée pareillement de faire commerce de la révolution allait
mettre la clef sous le paillasson à force de vols. Les zigotos,
certains furieux, ne manquaient pas, tous heureusement ne se
résumaient pas au fait de mettre à sac Maspero ou de menacer le
théâtre de l’U1. La môme Brassens, tiens, dont les facéties lui
valaient d’être régulièrement embarquée par les flics, ou
Armand Merlin provocateur toutes catégories qui à l’occasion
d’une séance de minuit du cinéma Bellevue alla jusqu’à
balancer une poule à travers la salle, beaucoup d’autres. Brassens
et Armand eussent-ils été de ces flibustiers qui écumaient la
culture bourgeoise ? Ce n’est pas médisance que de le présumer.
Pour ce qui est de notre théâtre, je ne saurais plus dire ce qu’il
s’est passé, le projet tourna court. Des embrouilles avec le CROUS
? Toujours est-il que notre travail ne fut jamais payé et que Daniel
et Christine P., disparurent de la circulation du jour au lendemain.

avec Angela Strehli
~ 12 ~
Jusqu’à
présent mon apprentissage musical n’avait pas moins été un échec
que ma scolarité et si l’on avait cherché à aller voir du côté
du fond de mon cœur c’est sur une bien pitoyable forme que l’on
eût abouti : rien n’était prêt, dix-huit ans pour du beurre. Or
qu’est-ce qu’un fond sans une forme ? Toutes les prescriptions
dont devait se targuer l’éducation pour être digne de sa finalité
avaient fait chou blanc. À cet âge-là, on est dans une telle purée
de pois que je ne sais pas si je m’en rendais compte comme je m’en
rends compte maintenant que j’y repense. Je ne vois qu’une
aspiration nymphale pour toute conscience. C’est dans cette mesure
qu’armé du saxo gercé que me prêtait l’école municipale de
musique de Lomme je rejoignis les répétitions d’un groupe de
rhythm’n’blues dans la cave qu’il occupait place de Gand.
Combien de temps répétai-je avec ce groupe ? Quelques semaines ?
Plusieurs mois ? Pourtant, noyé dans le maelstrom des riffs, je
trouvais que le groupe sonnait bien, ça me bottait : “Respect”,
“Cadillac”, “Mustang Sally” et autres morceaux du cru, mais
là encore je n’étais pas prêt. Une ou deux saisons plus tard je
retentai le coup, au chant cette fois, avec un trio qui, à l’autre
bout de la rue de Courtrai, se dotait d’un répertoire dans la
veine de Cream. Notre peu de matériel et l’imminence de l’appel
sous les drapeaux pour le guitariste et pour moi ne tarda pas à
couper l’herbe sous le pied de nos tendres velléités. Ni des
musiciens de la place de Gand, ni de ceux de la place aux Bleuets je
n’entendis parler par la suite. Ultimement, je me procurai un ampli
Bouyer et une basse Hofner Sunburst, la cousine de la basse violon de
Paul McCartney, à laquelle mon fils Julien fit rendre l’âme
trente ans plus tard.
C’était le temps
où Francis D., Eugène S. et moi fréquentions copieusement les
boîtes, notamment les légendaires “Ram Dam” de Dourges, où je
vis pour la première fois les Pretty Things en concert, et “Eden
Ranch” de Loison-sous-Lens où le trio Magna Carta étrenna son
premier LP. Il n’était pas rare que pour me rendre à Lens je
prisse l’autocar en gare routière à Lille et le dernier train à
Lens pour rentrer, ce qui faisait un court séjour là-bas, mais
l’Eden Ranch était un tel haut lieu ! D’abord le large café où
nous attendions l’heure de l’ouverture, puis la grande piste
entourée du déambulatoire constitué de loges en forme de wagons,
et la scène. Également une arrière-salle pour se restaurer. Je
laisse aux bons soins du lecteur l’intuition des anecdotes
pétulantes et triviales qui concoururent à cette jeune saga : trop
en rapporter estomperait la correspondance entre le rock suppléant
l’idéal éducatif et l’éprouvante émancipation du sujet.
Poursuivons donc avec l’épique escapade londonienne que nous
entreprîmes. Jean-Pierre M. s’était joint à nous. Pour ce voyage
nous disposions du coût du ferry-boat aller et retour pour nous
quatre et de dix francs par tête de pipe en petite monnaie. Ce fut
aussi spartiate que conforme à l’idée que nous nous faisions de
l’Angleterre car nous trouvâmes les Anglais gens fort
bienveillants, même les cops ! au point qu’à une trentaine de
kilomètres de Londres, une Jaguar, une MK2, fit demi-tour pour me
déposer à Piccadilly Circus où je ne retrouvai que Francis D. Ce
que nous fîmes ? Hormis traînailler et pioncer dans une cabine
téléphonique, pour le seul détail dont je me souvienne, je n’en
sais rien. Le retour en France fut la galère qu’il nous fallait
sans doute éprouver, et pourtant nous ne jurâmes pas que nous ne
recommencerions pas... Plus long et plus épique fut le tour de
France en autostop que peu de temps après Francis, Sylvie son amie
d’alors, et moi étions censés faire ensemble. Il n’en fut rien,
dès la bretelle de l’autoroute où notre départ à trois devait
avoir lieu nous perdîmes Sylvie. Nous la retrouvâmes à
Palavas-les-Flots où elle ne nous cacha pas que sa descente avait
été chaude, puis nous nous rendîmes à Valras-Plage où à nouveau
nous la perdîmes. Rendez-vous en Normandie. L’autostop fut aussi
hasardeux que notre périple direction Grandcamp-les-Bains fut
fastidieux. Nous marchâmes beaucoup, nous marchâmes surtout et même
tellement qu’il m’arriva de m’endormir en marchant. Et nous ne
mangions guère. Parvenus à la Maresquerie, à Grandcamp-les-Bains,
où j’avais été colon en 1963 et en 1964 et où Sylvie ne vint
jamais, nous nous sustentâmes de pommes durant une dizaine de jours
avant que de nous décider à reprendre notre route pour Loos où la
mère de Francis nous attendait avec un bon repas que mon estomac
sévèrement soumis au jeûne ne supporta pas.

avec Eddie Floyd
~ 13 ~
Ainsi que je l’ai
déjà laissé entendre, et si je ne l’ai pas laissé entendre je
le dis maintenant tout net, dans le Nord, cette époque que l’on
désigne du nom délicat de « trente glorieuses » ne signa aucune
prospérité sans rivage. À la fin des années 60, les industries
minière et textile avaient déjà entamé leur déclin et pour ce
qui est du plein emploi il n’offrait pas le visage souriant que
brossent les fables. Que je fus en instance d’aller accomplir mes
obligations militaires ne simplifiait pas les choses. Il fallait se
coltiner le flottement que ça occasionnait, les carrières de
certains chanteurs de rock en firent les frais ; pour bénéficier
d’un sursis, il fallait être étudiant. Mon employeur devint donc
Poly Interim, deux jours par-ci, trois jours par-là...
épisodiquement, et puis enfin pour quelques mois comme employé aux
écritures chez Pursan, à Marquette-lez-Lille, au bout de l’avenue
Industrielle qu’il me fallait parcourir sous les quolibets que me
valaient mon manteau maxi et les bottes d’officier allemand que
m’avait vendues le rexiste. Tout ce que les industries polluantes
avaient pu concevoir de fumées colorées était concentré à
Marquette, en plein cœur de la métropole : Massey-Ferguson, Grands
Moulins de Paris, Sté Decauville, Ciments Vicat, Dekachimie et
surtout le complexe chimique Kuhlmann-Rhodia sur 40 hectares partagés
avec La Madeleine et Saint-André. La santé des ouvriers et des
riverains n’était pas une jouissance, n’en déplaise à ceux que
le fantasme d’un renouveau industriel émoustille. La chef du
service auquel j’étais affecté était une authentique femme à
barbe dont la combinaison dépassait suffisamment de sa robe pour se
demander si elle ne forçait pas le trait à dessein. Dans le bureau
il y avait surtout Annie F. dont je tombai amoureux, et ceci m’amène
à me poser la question du ton qu’il me faudrait emprunter pour
revenir sur la préoccupation des préoccupations à cette période
de ma vie : l’amour.
Les
prétendants avaient beau être rockers, ils n’en continuaient pas
moins de convier les félicités de l’amour. Pour
ce qui est de l’eau fraîche, ils lui préféraient le whisky et ce
à quoi engageait l’évocation de la Cadillac : “My baby drove up
in a brand new Cadillac / My baby drove up in a brand new Cadillac /
She ain’t never ever, ever comin’ back // Baby, baby, baby, baby
please / Can’t you see I’m on my bended knees ? / My heart’s so
cold, I think it’s gonna freeze / Well, do the shake now // Yes,
come on now // Well my baby drove up in a brand new Cadillac / Well
my baby drove up in a brand new Cadillac / She ain’t never ever,
ever comin’ back // I said : “baby, baby, baby, baby please /
Can’t you see I’m on my bended knees ? / My heart’s so cold, I
think it’s gonna freeze”.
Quoique la
discipline familiale n’ait eu de cesse de me soumettre à une
chasteté érémitique, j’ai toujours été amoureux et je ne
voudrais pas que, en en faisant part sur le mode
chronologico-énumératif de cette véritable histoire d’amour, se
produise un effet déformant. Cet effet déformant que purent
produire, par exemple, certains de mes dessins, car un dessinateur
dessine, c’est-à-dire compose des ensembles de traits, je le
connais, c’est celui que l’on va retenir de vous. Le dessin,
fût-il érotique, est une affaire de crayon et de papier, le béguin
est une affaire d’émoi. À l’école maternelle Mozart j’ai été
amoureux. Aux cours de piano chez Schillio j’ai été amoureux. En
colonie de vacances à Wormhout j’ai été amoureux de Maryse et un
peu de sa copine Marie-José aussi. À Grandcamp-les-Bains j’ai été
amoureux de Brigitte et, l’année suivante, de Martine. Dans le
quartier où nous habitions j’ai été amoureux de Josette, et
j’aimais bien ses copines Michelle et Liliane. Également de filles
que je croisais en allant à l’école, je pense à Édith. Durant
les années de collège il y a celles qui furent amoureuses de moi
mais auxquelles ma timidité retint de répondre. Être amoureux et
timide : beau hiatus ! Ce qui changea avec, à dix-sept ans, la
permission, enfin, de sortir en clubs c’est la découverte du flirt
essentiellement permis par le slow. Lumière subitement tamisée, le
temps suspendait son vol, ce n’était plus la roue qui tournait
mais la boule de cristal : corps se cherchant, les cœurs se mettant
à battre la chamade, corps se frôlant, se pressant, puis plus fort,
“Sweet little sixteen”... “Only sixteen”... “You’re
sixteen”... “Happy birthday sweet sixteen”... tant d’hymnes à
l’amour dont nous fûmes abreuvés. Il y eut encore une Josette,
Dorothée, Marlyne, Michèle, Nadège dont la sœur, comme dans la
chanson de Boby Lapointe, me plaisait davantage, toute cette
ribambelle des prénoms emportée comme feuilles mortes par le vent
du nord, appelons-le ainsi. Je ne revis une dernière fois Annie qu’à
l’occasion de l’unique permission du service militaire qui,
coïncidant avec le nouvel an, n’interdît pas qu’elle pût
passer la nuit chez nous... mais pas dans ma chambre.
“I’ll
buy you a Chevrolet / Buy you a Chevrolet / I’ll buy you a
Chevrolet. / Just give me some of your love / Just give me some of
your love / Just give me some of your love, gal / Just give me some
of your love. // I don’t want your Chevrolet / I don’t want your
Chevrolet, yeah / I don’t want your Chevrolet. / Just give me some
of your love, man / Just give me some of your love / If you just give
me some of your love, man / Just give me some of your love. // I’ll
buy a Ford Mustang / I’ll buy you a Ford Mustang / I’ll buy you a
Ford Mustang. / Just give me some of your love now / If you just give
me some of your love, man / Yes, just give me some of your love, man
/ If you just give me some of your love. / I’ll buy you a Cadillac
/ I’ll buy you a Cadillac / I’ll buy you a Cadillac. // If you
just give me some of your love, gal / If you just give me some of
your love / If you just give me some of your love, gal / Just give me
some of your love. / I don’t want your Cadillac car / ‘Cause
you’re all shiny black / I don’t want your Cadillac.”
avec Jackie Mc Aulay (Poor Mouth)
~ 14 ~
La différence entre
ce qu’on comprend et ce qu’on ne comprend pas ne tient pas
seulement au fait qu’on comprenne ce qui est compréhensible et
qu’on ne comprenne pas ce qui est incompréhensible, quoiqu’on
puisse aussi ne pas comprendre ce qui compréhensible, mais plus
encore au fait que s’il semble logique d’interroger ce qu’on ne
comprend pas, réciproquement se demander pourquoi on comprend ce
qu’on comprend (ou ce qu’il semble qu’on comprenne) soit pure
futilité. De la même façon la vérité de l’histoire du rock
n’est ni une pure question idiote de vérité ni une question
historiographique, c’est l’histoire entremêlée de réponses
présumées intelligentes à des questions idiotes et de réponses
idiotes à des questions présumées intelligentes, grosso modo et
pour dire vite. Laissons aux dictionnaires leur science, aux forts en
thèmes leurs propriétés et goûtons l’humaine digression avec
les latérales auxquelles elle donne accès. La suite dans les idées
repassera.
Première
digression : l’amour. Tout thème que fasse l’amour, il n’en a
pas moins valeur à chaque chanson nouvelle de foudroyante
digression. Le rock est fait de chansons et les chansons, quand elles
ne prennent pas la tête, parlent d’amour. Donc le rock a à voir
avec cette chose improbable qu’il n’a pas inventée : l’amour.
Comme de l’amour à l’ivresse la route est directe, le rock a à
voir avec l’ivresse, ivresse aveuglante de l’amour sur l’air de
“One bourbon, one scotch, one beer” ou “Drinkin’ wine
spo-dee-o-dee”. Si le rock avait été un produit importé de
Russie c’est la vodka qui aurait eu la faveur de cet insigne
compagnonnage, s’il avait été importé du Japon ç’aurait été
le saké, s’il avait été importé de la Martinique ç’aurait
été le rhum. Dans l’hexagone et en Belgique c’est à la petite
mousse que revient la palme, l’hymne des Garçons Bouchers en fait
foi. L’amour n’est jamais qu’un prétexte.
D’autres
digressions entrent dans le vif des préoccupations du rock :
contestation, contestation vite enrôlée par l’enjôleuse passion
du lucre (un rocker sans argent n’est-il pas comme un criminel sans
crime, un charcutier sans tripaille, un rimailleur sans rime ni
raison ?), bagarres, nature (nature ? non, foin de la nature,
enlevons-la !), solitude, etc. Le rock est une forme, pas un fond. Je
ne dis pas qu’il est sans fond, seulement que ce fond, à la fois
dans sa forme et à côté d’elle, voire derrière, est mouvant,
flexible et fluctuant. Ces formes ce ne sont pas que des histoires,
c’est aussi à la bite me the knot le ciment du vécu. Et ce
ciment, c’est la vie ! À un pas de côté la vraie vie ? S’il
est une chose dont a envie à un moment de sa vie celui qui a des
choses à dire c’est de l’extirper de la gangue maternelle : “Si
j’avais un micro / Je chanterais le jour / Je chanterais la nuit /
J’y mettrais tout mon cœur / Je défendrais la terre / Je
chasserais la misère / Y aurait plus d’amertume / Je décrocherais
la lune / Oh oh, ça m’f’rait une belle fortune”. Comme dans la
chanson de Gilbert Bécaud celui qui a des choses à dire dirait
combien il en ferait son affaire, mais pour en faire son affaire il
lui faudrait d’abord savoir la faire, ensuite avoir un air. Or pour
avoir un air, il faut savoir jouer. Avoir l’air ne fait pas la
chanson.
De quoi la chanson
est-elle faite ? Beaucoup cherchent l’absolu, la plupart appellent
ça “Love”, “Money” ou “God” (alias Eric Clapton) mais
rares sont ceux qui trouvent ne fût-ce qu’un sentiment tangible de
proximité avec cet absolu. Qui s’est jamais offusqué que ce
sentiment soit appelé “amour”, “pèze” ou “dieu”, les
noms ne sont que ce qu’ils sont, nom de nom ! L’absolu n’est
d’ailleurs pas fait pour les paumés ! Tout fait sens. À l’instar
du sens giratoire de la place Vendôme où tomba des nues le plug
anal que l’on sait, l’Art Contemporain aussi fait sens. Le sens
est partout, ici dans la boîte aux chocolats, là avec un goût de
vinaigre. Au paradis avec les ânes, Bouguereau et Duchamp s’en
battent l’œil...
Si j’avais une
plume, j’aimerais radiographier le charabia qui se passe dans
l’esprit avant qu’il ne pense qu’il pense. Combien faut-il de
pensers mis à la queue leu leu pour faire une pensée ? Pour faire
une chanson ? D’ailleurs tous ces livres sur le rock, ici le minois
de John Lydon en cover, là ceux érodés de Pierres qui ont roulé
carrosse jusqu’à la lie, toute cette mythologie... Quels grains de
sel ajouter ? Si le rock c’était du blablabla, le blablabla serait
l’essentiel. Si j’avais une Télécaster, j’aimerais être la
main de ce qui lui vient à l’esprit, parce qu’avec la Hohner L75
c’est bal du samedi soir et compagnie. Expression ou impression ne
sont pas tant que ça des choses à prendre avec des pincettes... On
peut aussi se les permettre au lance-pierre.
Alvin Lee (Ten Years After)
~15~
Le
guitariste du second groupe avec lequel je m’étais aventuré, un
Jean-Claude dont j’ai oublié le nom, me l’avait certifié : avec
le piston qu’il attendait de la très bonne relation qu’il avait
avec un parent général, nous avions lui et moi l’assurance de
faire notre service militaire à Lille ou en tout cas dans le coin,
ce qui allait nous permettre de pouvoir mener à bien nos
répétitions. Tous les espoirs étaient-ils permis ? L’ordre
d’affectation que je reçus un beau jour de mai 70 m’enjoignait
de rejoindre la caserne Schramm à Arras, tout était donc pour le
mieux. Arras et Lille n’étant qu’à quelques encablures l’une
de l’autre, toutes latitudes pour ne pas démériter du rock
m’étaient confiées. Équipé du plus léger des bagages qui fût,
je me présentai donc à ladite caserne sans même avoir prêté
attention à la mention “FFA” dans un coin du document, et je
crois bien que j’étais le seul. FFA signifiait Forces Françaises
en Allemagne, et le train militaire qui allait nous emmener très
loin de Lille avait Berlin pour destination. C’était tellement
gros que je ne me souviens pas avoir été catastrophé, je me
demande même si l’effet pochette surprise n’occulta pas le
désarroi qui eût dû être le mien, parce qu’enfin c’était
quoi cette affaire ? Le général qui devait intercéder existait-il
seulement ? Le temps que dura le voyage me sembla long, le train
était loin d’être un TGV, et puis surtout il fallait traverser la
RDA (République démocratique allemande, en allemand DDR pour
Deutsche Demokratische Republik). C’était une aventure. J’entends
encore cet ostrogoth qui, à la frontière, ouvrit la fenêtre alors
même que nous avions reçu l’ordre de tirer les rideaux et ne pas
regarder au dehors, et se mit à chanter à tue-tête : “Il était
socialiste ? Il était communiste ? Il était un petit ministre qui
n’avait ja, ja, jamais gouverné, ohé, ohé !”, ce qui fit
débouler la police militaire en moins de temps qu’il n’en faut
pour le dire. La RDA j’avais vaguement entendu parler d’elle par
un petit livret de propagande sans doute rapporté de la fête du
quotidien communiste “Liberté” ainsi que par mon ami Francis D.,
dont les parents étaient aussi communistes et qui, adolescent, était
allé tâter de la colonie de vacances de l’autre côté du rideau
de fer.
Ce service militaire
se déroula dans le bain permanent de la présence ennemie
matérialisée par le fameux mur le long duquel il fallait
patrouiller, les nids de mitrailleuses dans les stations de métros
de la partie est de la ville que desservait le métro S-Bahn, les
patrouilles Lübars qui consistaient à aller faire du repérage de
l’autre côté du mur dans de grosses Mercedes blindées ou encore
assurer le gardiennage de Rudolf Hess dans sa prison de Spandau. Des
trucs dans ce genre-là. À part ça, nous passâmes une partie non
négligeable de l’année à nous entraîner hebdomadairement pour
le défilé interallié du 8 mai. Quoiqu’il s’en fallût de
beaucoup que nous fussions un régiment de parade, le casernement
dans une ville qui était le centre de gravité de la guerre froide
avec ce qu’il requerrait de représentativité nous valut un séjour
des plus confortables. Berlin ne tirait pas de plans sur la comète,
son statut interstitiel et le sentiment du provisoire qui en était
le fruit se prêtaient comme un gant à ce que le rock s’y fît une
prédestination. L’existence suspendue, comme ce qu’on dit du vol
à propos du temps, s’accordait avec une certaine légèreté dont
le Berlinois de l’ouest tirait son amabilité, très subjectivement
je trouvai une trentaine d’années plus tard combien le tempérament
du Berlinois de l’est venait d’une autre école, et j’ai
beaucoup plus zoné du côté du Ku’damm que dans la caserne. Quand
je rentrais vers 1 h du mat’ de mes déambulations, je retrouvais
les copains en train de festoyer à coups de boîtes de choucroute ou
de cassoulet sur fond de Led Zep’, Pink Floyd ou Léo Ferré. Il en
résulta qu’entre Deep Purple avec bidasses en folie ou Wagner au
Deutch Oper c’est vers le second que je me tournai. De Pink Floyd
ou Led Zeppelin, je ne suis jamais allé beaucoup plus loin que les
deux premiers LPs, quant aux Deep Purple, Black Sabbath et autre
Cactus, ils ne m’ont jamais procuré de frissons outre mesure. Je
trouve encore aujourd’hui que 1970 fut un moment charnière dans
l’histoire du rock. Avec les possibilités d’allonger la sauce
offertes par le 33 tours, les groupes prirent l’habitude de se
répandre. Tant du côté du hard rock que de celui du rock
progressif, les longs, voire interminables, solos instrumentaux
s’accordèrent de plus en plus de place, pour ne rien dire du disco
où se dilua peu à peu l’élégante soul music ou du jazz : la
marchandisation triomphante du rock était mûre pour la longue
durée, par-delà le bon grain et l’ivraie l’accumulation
primitive du genre allait faire place aux sous-genres, aux
sous-sous-genres et aux sous-sous-sous-genres. Je ne nie pas que
l’intelligence ait pu y trouver son compte, seulement que trop de
sous-sous-genres et de sous-sous-sous-genres ont tué les genres et
même les sous-genres. C’est tout, rien de plus.

Wilko Johnson
~ 16 ~
Quartier
Napoléon, Berlin 1970-71. Bien qu’à deux reprises nous nous
soyons offert le luxe de grèves de revue d’armes et de revue de
chambrées, ce qui n’était déjà pas peu glorieux, notre
antimilitarisme plus spontané que politique n’eut jamais à se
coltiner l’épreuve des faits ainsi que, nous avait rapporté la
rumeur, ça avait été le cas à Baden-Baden. Il suffisait de dire
que nous n’aimions pas l’armée. C’est après coup que je me
suis rendu compte que cette année de service militaire fut pour moi
une providence. Primo elle provoqua une rupture devenue pressante
avec le ghetto familial et avec le degré zéro du confinement
professionnel qui me pendait au nez, secundo elle me largua dans une
ville spacieuse dont je m’épris tout de suite, tertio elle
occasionna quelques rencontres décisives : un break initiatique. La
dactylographie qui m’avait valu l’insigne honneur d’entamer la
vivifiante carrière de dactylo-facturier me permit ici d’accéder
à l’inestimable planque de secrétaire de compagnie. Dans la
chambrée, nous étions quatre mais comme de 16 h 30 à minuit nous
avions quartier libre, je n’eus pas à supporter l’insupportable
concurrence de leurs stations de radios respectives, j’étais tout
le temps dehors : bibliothèque et librairie françaises, musées,
coffee-shops underground, moins fréquemment boîtes de nuit et à
plusieurs reprises le Deutsch Oper où s’innerva la passion de
l’art lyrique. Également le Schillertheater où, avec ma mère
venue me rejoindre pour une semaine, nous allâmes voir une comédie
musicale. Et si je ne faisais pas le mur pour déserter la caserne,
je dessinais ou lisais. Cette indépendance, tout à coup, quel luxe
! Et qu’elle fût redevable au service militaire, quel paradoxe !
De ce rock dont je me mettais à remercier un engouement vieux de dix
ans je ne percevais plus que les électrophones criards dans les
chambrées quand je rentrais de mes virées. Dans l’ensemble, les
gars ne s’aventuraient pas trop en ville, perpétuer la renommée
haute en couleur de l’éternel trouffion leur était préférable.
À cette insouciance
providentielle jusque-là insoupçonnée, se mêlèrent trois amis :
Olivier B. à qui je dois mes premiers aiguillages poétiques et
politiques, Daniel G. qui ne se mêlait pas non plus aux agapes de
ses semblables et qui, grand amateur de Klee, Kandinsky, Alechinsky,
Soulages, etc., peignait. Dans la musique régimentaire, cymbaliste,
Christian G., dans le civil étudiant en classe de chant au
conservatoire de Rouen. Et puis il y avait Margitta, mon petit flirt
au délicieux accent berlinois. Du “Caras” à l’angle du
Ku’damm et de la Joachimstaler Straße, partaient nos promenades
vers le lac Tegel, le musée Brücke ou le parc du château de
Charlottenburg. Je me souviens de son visage pour l’avoir dessiné,
également de détails retenus à la mémoire par leurs noms, mais ce
dont je ne me souviens pas c’est de la façon dont j’étais
amoureux. Question à cent balles, certes, l’état amoureux ne se
résume pas à grand-chose, il ne lui suffit que de flotter sur son
petit nuage. Malgré tout je reste sur une impression frustrante
d’étourderie. Il y a à cet endroit un trou blanc comme il s’en
trouvait encore sur les cartes d’Afrique quand j’étais gosse,
impression qu’il manque quelque chose de moi à la compréhension
de mes jeunes émois. À cet âge-là, la maladresse n’est pas la
meilleure opération de l’esprit pour accorder ses sentiments. Être
amoureux ce n’est pas comme devenir musicien, aucune classe de
conservatoire pour apprendre à contenir les battements du cœur.
C’est une chose qui ni ne peut précéder l’instant tant attendu
ni ne peut lui succéder, Jules Jouy avait déjà dû dire quelque
chose comme ça. Quand même, j’aurais aimé disposer de mon amour
à quinze ans aux Bois-Blancs, à dix-huit ans à Allevard, à
dix-neuf à Palavas ou là-bas à Berlin. Être jeune, c’est ne pas
savoir, et ce non-savoir est le goût volatil de revenez-y qu’il
laisse. On ne peut pas désirer savoir ce qu’on n’a pas su sans
se souvenir qu’on n’a pas su. S’il fallait évaluer son niveau
de jeunesse, cette chose que tout le monde convoite en vieillissant,
le non-savoir en serait un bon indicateur, le non-savoir et le désir
de savoir, le goût d’apprendre, le désir. Seulement sans
brouillard pas de dissipation. Mais il n’y a pas de raison que je
sache pourquoi je dis tout ça.
Le meilleur de la
musique fait appel à la disposition, à l’humeur, à la liberté
de changer de disque ou comme ici de composer avec ce à quoi le
milieu ambiant nous contraint. Après que Serge Gainsbourg ait
excellemment dit “Je t’aime moi non plus”, j’ai fait mon
évidence du fait que, tout comme dans la musique indienne il y a des
ragas pour les différents moments de la journée, il y a dans ma
musique des séquences où alternent temps forts, temps faibles,
leitmotive, réminiscences, silences, etc. À cette époque-là le
rock ne s’imposait plus. Ce ne serait pas la première fois.
Steve Hooker
~ 17 ~
1er
juin 1971, de retour de Berlin, soirée chez mes parents. Rien
d’acquis derrière moi, rien de bien projeté devant si ce n’est
rejoindre la ville des surréalistes, rencontrer les poètes. On peut
parler de rêve. Je ne me souviens pas de m’être rendu compte
combien à ce confortable répit berlinois sous les drapeaux était
en train de succéder un grand plongeon dans l’inconnu. Avant tout,
avant toute considération, avant toute estimation, ce que je m’étais
promis : quitter la maison familiale, mettre les voiles. Mon père ne
commenta pas ma décision — j’étais majeur n’est-ce pas ! —,
nous sommes-nous même dit un mot ? Mon père... Mon père qui
avait coutume de dire : “Faut pas faire autrement que les autres
!”. C’était son credo (chaufferette en hiver, ventilo en été,
point d’appui, antienne, vermifuge de fonction, sésame, reposoir,
conviction de service, assurance vie à prix cassé, etc.). Oui mais,
que font les autres ? Théoriquement, ils font comme les autres. Soit
ils se ressemblent, soit ils s’imitent. Dans un cas comme dans
l’autre ils convoquent Pierre, Paul, Jacques pour se blanchir la
cosse. S’ils ne faisaient pas comme les autres, ils n’en seraient
pas moins des autres mais des autres qui font autrement.
Littéralement, les autres qui font autrement ne sont pas les mêmes.
Tenait-il tant que ça à ce que je prisse pour argent comptant son
impératif catégorique ? Je n’ai jamais été un rebelle au sens
déterminé du terme. Avec les résistants autoproclamés, les
rebelles, en tout cas ceux qui n’appartenant pas à une minorité
ostracisée se présentent comme tels, sont en général
d’insupportables hâbleurs. Un rebelle, ou ça essaime son
adversité ou ça décanille, autrement s’arroger clef en main une
rébellion dans une société qui en fait de la plus-value, c’est
du pain bénit, pas de l’alchimie. Loin de moi de vouloir accabler
la mémoire de mon père : ma mère a mal vécu avec lui, il est
probable qu’en retour elle lui était insupportable. Les enfants,
on ne leur dit pas : “Tiens, viens t’asseoir près de moi, on va
voir ça !”, leurs yeux embués voient se succéder les discordes à
l’ombre d’enjeux trop exigus pour leurs petites têtes. En dépit
de toute trêve, concédons qu’il ne devait pas être si simple
d’aller pelleter ses tonnes de charbon et d’assumer son rôle de
père.
Le lendemain matin,
ma mère me donna un billet de 50 fr et je pris le chemin de la
capitale. Ce ne fut pas plus sorcier que ça. Une fois sur place,
autant Berlin avait été spacieux, accueillant, autant Paris était
étroit, encombré, stressant. Ce jour-là tout se passa très vite,
une bière au “Départ Saint-Michel”, puis Armée du Salut afin
de solliciter un lit pour la nuit, évidemment il n’y avait pas de
place, puis retour au Quartier latin où tout à fait par hasard je
rencontrai Daniel G., mon ami artiste peintre du quartier Napoléon,
à qui je fis part de la précarité de ma situation. Toujours par
hasard — dans ces années-là j’eus souvent l’heur d’apprécier
la précieuse intercession du hasard —, Daniel G. me proposa
d’occuper le grenier où il remisait son matériel, rue de Passy, à
deux pas du Palais de Chaillot. C’était inespéré. Dans la
foulée, je me présentai le lendemain à une boîte intérimaire qui
aussi sec me plaça comme employé aux écritures dans une banque, la
Société Industrielle de Crédit, sise à deux pas des Champs
Élysées, rue Lammenais. La secrétaire de cette boîte me proposa
de me dépanner d’une batterie de cuisine, sans doute eût-elle
aimé que j’accepte... Je ne gagnais pas bésef mais le prix
démocratique du ticket de cantine me permettait d’aller découvrir
Eisenstein, Bergman, Abel Gance, Jean Eustache, Serge Bourguignon ou
Godard à la Cinémathèque du Palais de Chaillot. Un continent
s’offrait à moi dont je pouvais désormais soulever la couverture. Ainsi,
un soir, tandis que du toit auquel ma cambuse donnait accès je
contemplais les étoiles, j’eus tout à coup droit à une
authentique démonstration d’acrobatie en contrebas, de l’autre
côté de la rue. Par la fenêtre d’un appartement du 4ème étage,
je vis sortir un monte-en-l’air qui très rapidement se laissa
tomber sur l’étroit balcon de l’appartement du 3ème dans
lequel, pfuit ! il n’eut qu’à s’engouffrer. Un autre soir
c’est à ma propre lucarne que je vis une silhouette qui, à peine
m’y étais-je précipité, détala dans la nuit sans demander son
reste. Le peu que je vis de cette silhouette me donna à penser qu’il
s’agissait d’une femme... Des choses comme ça, sur les toits de
Paris. Pourtant
il me faut bien dire que, hormis une charmante voisine de vasistas
avec qui je discutais le soir et deux petites postières d’en face
qui me gratifiaient régulièrement d’un strip-tease à leur
fenêtre, je ne rencontrai ni ne rencontrerais le poète
surréaliste espéré. Il me suffisait de dévorer tout ce qui
m’avait fait défaut jusque-là : Éluard, Bataille, Blanchot,
Sade, Breton, Nietzsche, René Char, et je m’offrais des disques que
j’écoutais interminablement : Chopin, Beethoven, Rachmaninov, Léo
Ferré, Jean Ferrat... Il me semble que je devais avoir l’air très
romanesque quand riche d’une solitude authentique j’allais
prendre le soleil sur les bancs du Palais de Chaillot. Plus le
moindre disque de rock, sans doute cela reviendrait-il dans deux ou
trois ans, seulement la tête ailleurs.

Buddy Guy
~ 18 ~
Avais-je
la tête en l’air, quand, me rendant à la Cinémathèque ce
soir-là, j’entendis derrière moi une voix m’appeler par mon
prénom ? Je vis que c’était... Olivier, Olivier B., mon cher
vieux pote de la 3ème Cie à Berlin, qui allait également à la
Cinémathèque. C’était à peine croyable ! À aucun moment nous
ne nous étions rancardés, il était de Metz, moi de Lille, et là,
quatre ou cinq mois après avoir été libérés de nos obligations
militaires, nous allions d’un même pas, dans la même ville, voir
le même film. Olivier B. créchait avenue Mozart, à dix minutes du
grenier que j’occupais rue de Passy. Olivier c’était quelqu’un
! Un foutu caractère quand il voulait ou alors charmeur, bien que ce
charme ne fût jamais totalement dénué d’ironie. Entré comme O.
S. dans le bâtiment à quatorze piges, il était parti à Paris pour
bosser aux PTT et rallier l’organisation UJCML dissoute en juin 68.
À Berlin, lui et moi n’avions jamais manqué une occasion de
discuter de ce qui ressortissait à la politique, à l’art, à la
poésie. C’est en sa compagnie que j’avais fréquenté la bonne
bibliothèque de l’Institut français ou étais allé à plusieurs
reprises au Deutsch Oper. Il n’était pas rare qu’on nous prît
pour des frères. Du coup, nous étions appelés à nous revoir
souvent. Mon job d’employé de banque m’ennuyait profondément.
Vacuité totale. Le service des remboursements anticipés où j’étais
affecté avait des tonnes de dossiers de retard et mon cerveau se
refusait à mémoriser leurs clauses multiples. Incompétence et
tenue vestimentaire que les canons de l’élégance bancaire
n’effleuraient pas, quoiqu’on ne m’en ait jamais fait la
remarque, me susurraient qu’une enviable perspective
professionnelle était en train de me glisser entre les doigts.
Ils avaient
tellement chanté la Ville Lumière les Mouloudji, Lucienne Delyle,
Yves Montand, Suzy Solidor, Maurice Chevalier et tant d’autres. Le
dernier fut probablement Léo Ferré avec ce titre à double
tranchant “Paris, je ne t’aime plus”. Après quoi, on cessa de
la chanter. Moi non plus je n’étais pas sûr de l’aimer tant que
ça avec sa pollution, sa cohue, ses jeunes filles aux mains
baladeuses dans le métro, ses gendarmes à chaque coin de rue. Il
restait bien pour très peu de temps le quartier des Halles, le petit
caboulot de la rue de Seine ou Mouna Aguigui, “dernier amuseur
public de Paris”, mais il n’était pas difficile de comprendre
que de dernier il n’y en a jamais qu’un, qu’après c’est
panégyrique et compagnie. S’imagine-t-on une école où il n’y
aurait que des derniers ? Je sais de quoi je parle ! Olivier ayant
largué le Centre de tri de la poste où il n’avait repris du
service que pour mieux tirer sa révérence, je récupérai sa
chambre de l’avenue Mozart. Nul n’ignore que le XVIe
arrondissement ce n’est pas que la bourgeoisie mais, au fur et à
mesure de l’ascension dans les étages, des chambres de bonnes. À
la fenêtre toujours grande ouverte de l’une de celles de la cour
intérieure sur quoi donnait la mienne, deux nouvelles
strip-teaseuses et même plus. Exhibitionnistes, Arsène Lupin et
autres monte-en-l’air, le Paris des chambres de bonnes et des toits
était loin d’être inintéressant.
Nous retrouvant,
Olivier, très vite revenu d’Aix-en-Provence, et moi à la terrasse
du Café Kléber, place du Trocadéro, nous admîmes qu’il était
temps de laisser la capitale à ses brumeuses humeurs. Pour quoi
faire ? Pour quel projet ? Ça, ma foi, nous n’en savions rien, et
c’est quand même amusant, quand je pense qu’aujourd’hui rien
ne me semble plus contrariant que l’idée de voyager, ne parlons
pas de vacances, là je me voyais déjà plaquer cette sécurité
vouée aux écritures, insignifiante certes mais quand même, pour
Dieu sait quelle aventure au diable vauvert à n’en pas douter.
Reparcourir pour notre compte l’expertise de la non-adéquation des
faits usuels avec le travail au long cours de l’esprit était ce
qui nous incombait. Processus foncièrement énigmatiques comme
aspirations naturellement abstraites y avaient leur siège. Bien
d’autres avant nous l’avaient dit, il existait une réalité plus
vaste et plus intense, révélée par l’art, la poésie, la pensée,
le légitime désir de briser les chaînes, qui de toutes part
démentait que la déflation de réalité dans laquelle nous
pataugeons fût le milieu naturel de l’existence. Tributaires du
peu qu’elles donnaient à voir comme essentiellement incluses dans
leur dépassement, les choses n’étaient pas ce que l’inattention
ou l’attention banale leur prêtaient de facticité mais pour des
raisons que nous allions nous faire fort de trouver inscrites au
verso auraient une vie off, parallèle, clandestine. Ce soir-là, un
mendiant aveugle dirigé par une très jeune femme vers notre table
enleva ses deux yeux de verre pour attester de sa cécité après que
nous lui eûmes refusé l’aumône. C’était dit, passer à
l’acte, vite ! Le lendemain je donnai mon préavis à la Société
Industrielle de Crédit.

Kim Simmonds (Savoy Brown)
~ 19 ~
Je
ne saurais dire si notre destination résulta de la fléchette que je
lançai au petit bonheur la chance sur une carte de France épinglée
au mur ou bien du souvenir des jolies filles que Francis D. et moi
avions regardé passer sur leurs Solex tandis que nous faisions route
vers Palavas trois ans plus tôt. Dans le doute, j’opte pour les
jolies jeunes filles. Allez, le temps d’empocher mon restant dû et
adieu morne banque, cap vers le sud ! Ce serait Avignon. Belle
gageure pourtant que de vouloir sortir de Paris en autostop, au bout
de deux jours passés à poireauter en vain Porte d’Italie, nous
dûmes nous rabattre sur la Gare de Lyon, qu’Olivier n’eût pas
le moindre sou importait peu. Une fois débarqués à Avignon, vite
trouver une chambre meublée et un job. Pour ce qui est de la chambre
nous en trouvâmes une rue Banasterie, mais pour le boulot, en 1971 à
Avignon, un claquement de doigts ne suffisait pas à ce qu’il
tombât tout rôti. Avant que l’ANPE nous proposât un emploi nous
finîmes par nous résigner, Olivier à aller faire la manche avenue de la République et moi, que l’idée
de mendier révulsait, à faire les poubelles — faire les poubelles
n’étant pas moins dégoûtant que de mendier. J’ai aussi volé
sur l’étal d’une épicerie place des Corps saints... un sac de
noix, avant que de filer ventre à terre dans la première rue
adjacente. Je me souviens encore de l’endroit. Plus dérisoire, tu
meurs ! Heureusement la probation ne dura pas trop longtemps, l’ANPE finit par nous trouver
à tous deux un job de ripeur au marché gare, à la Compagnie
fruitière nerveusement dirigée par trois frères : soixante heures
hebdomadaires de nuit à charger, décharger des poids lourds. Pour
ce qui est de la flexibilité dans le travail, le XXIe siècle n’a
rien inventé, et encore je n’avais pas tout vu. Si mes bras
supportaient les 7/8 tonnes charriées quotidiennement, le plus
difficile devint vite pour moi d’arriver à l’heure : 2 heures du
mat’ (1 heure du mat’ le lundi), là-bas au bout de l’avenue
Pierre Sémard, 4,5 kms à pied par tous les temps. Brrr ! Avec son
mistral, l’hiver provençal n’est pas moins glacial que l’hiver
nordiste, et mon sommeil a toujours été de plomb.
Insensiblement,
Olivier devenu ténébreux et moi ne nous entendîmes plus. Alors,
comme il devait en avoir assez de la manutention qui n’est
évidemment pas ce qu’il est convenu d’appeler “une perspective
d’avenir”, il repartit pour Paris à mon grand soulagement. Le
cours des choses reprenant de sa bonace, je m’adonnai en toute
quiétude au flirt avec la gentille Isabelle rencontrée dans un club
de la rue Corderie. Au travail, parmi les copains que je m’étais
fait, ma sympathie allait à Henri B., natif de Graveson. Henri B.,
d’une quinzaine d’années mon aîné, était à l’instar de Mr
Jourdain du genre anarchiste sans le savoir, j’en ai connu
quelques-uns comme lui dans le Vaucluse : une fois le boulot terminé,
costard cravate et ni vu ni connu, fier de dire qu’il ne
connaissait plus personne il passait à autre chose, il reprenait sa
liberté d’être autre, c’est-à-dire lui-même. Au travail, lui
comme moi étions doublement des rapides et des minutieux : avec
nous, les caisses étaient toujours alignées au cordeau. Une fois,
Henri se paya même le luxe après une soirée terminée tard, et
sans doute un peu arrosée, de venir directement au marché gare et
de se vider à lui tout seul un semi-remorque avant que la boutique
n’ouvre. Pour aucun de nous deux il n’était question de faire du
zèle, seulement de ne pas rester les bras ballants, de ne pas nous
ennuyer. Est-ce pour cela que contrairement à ce que je commençais
à craindre, mon manque de ponctualité au travail ne me valut aucun
rappel à l’ordre ? Aussi étonnant que cela parût, les patrons
qui étaient loin d’être du genre pied-tendres me promotionnèrent
vendeur.
Avec là-bas le Mont
Ventoux visible à l’occasion de livraisons à Châteaurenard ou
vers Carpentras, je sentais bien la légendaire présence de ce
Vaucluse des troubadours, seulement j’étais assigné à Avignon
comme l’étaient les repris de justice, c’est ainsi qu’à “La
Pyramide”, illustre gargote avignonnaise de la rue Philonarde, je
dînais régulièrement en compagnie d’un monsieur qui m’avait
confié avoir assassiné sa femme. Pourtant, astreint à la première
nécessité de survivre, j’en vins à me ranger à l’avis de ceux
qui, en dépit du coup de chauffe estival que constitue le festival,
trouvent Avignon de peu. Comme nombre d’autochtones je n’ai
jamais assisté à la moindre représentation théâtrale dudit
festival où seul le touriste, fût-il avignonnais, a sa place. Ce
n’est que pour des raisons extrathéâtrales qu’ultérieurement
j’aurais l’occasion de croiser les deux compagnies locales :
théâtre des Carmes d’André Benedetto et théâtre du Chêne noir
de Gérard Gelas. Pour le retour à la case rock, c’est à la
Maison pour tous du quartier de Champfleury qu’avec le groupe
Family je repris de mon vieil attachement suspendu depuis un an et
demi. Autant le rock, ou en tout cas ma passion pour le rock, était
apparu comme une réponse à une question qui ne semblait pas avoir
été posée, ou s’imposa comme une réponse à une question
oubliée, ou qu’on avait négligé de me transmettre, autant...
Autant, quoi ?... Il y a une formule proverbiale qui dit :
poser la question c’est y répondre, est-il possible qu’il y en
ait une seconde, corrélative, qui dise : la réponse c’est la
question ? Qu’est-ce qui provoqua, ou motiva, ma passion pour le
rock tandis que j’entrais à peine dans l’adolescence ? Eh bien,
je peux le dire : si ce n’avait pas été le rock, ça aurait été
autre chose. C’est aussi évident que ça. Si j’étais né trente
ans plus tôt, ça aurait été une certaine musique classique, ou le
swing, ou les marches militaires, allez savoir ! Si j’étais né en
Asie centrale ça aurait été le mugham, si j’étais né trente
ans plus tôt en Corée ou en Afrique ça aurait été des
assemblages de sons et de silences de par là-bas. Toujours de la
musique. Réciproquement, je me dis que si Mozart était né aux XXe
siècle, n’en déplaise aux mélomanes, mélophiles et mélolâtres
associés, il aurait probablement emprunté au jazz ou fait le bœuf
avec Frank Zappa.

John Gypie Mayo (Dr Feelgood ; The Yardbirds)
~ 20 ~
Un soir de décembre,
je prenais un verre à la brasserie à côté du cinéma “Le
Palace”, cours Jean Jaurès, quand une jeune étudiante qui était
derrière moi me tapa sur l’épaule et me tendit un tract.
Celui-ci, signé “La Cause du peuple”, du nom de l’organisation
maoïste éponyme, retint d’autant plus mon attention qu’avec
Olivier la lutte des classes et cette organisation en particulier
avaient fait l’objet d’ardentes discussions. J’ai dit plus haut
qu’il avait été militant à l’UJCML, UJCML qui à sa
dissolution en juin 68 s’était muée en Gauche prolétarienne et
son journal “Servir le peuple” en “La Cause du peuple”. La
Gauche prolétarienne avait été à son tour interdite en mai 1970
et n’avait plus survécu que sous le nom de Cause du peuple jusqu’à
son autodissolution en novembre 1973. Cette étudiante était en
compagnie d’autres maos, je me joignis à leur tablée. À Paris
j’avais été client régulier des librairies Maspero et Norman
Béthune où je me procurais la littérature révolutionnaire, c’est
en connaissance de cause que je m’étais promis de rejoindre
l’organisation quand l’occasion se présenterait. C’est ainsi
que j’intégrai le groupe avignonnais, groupe qui, j’allais très
vite le découvrir, était fort excentré par rapport à une
organisation nationale des plus empiriques : Avignon n’était que
la petite ville qu’on traversait pour se rendre à Marseille,
Bernard et Jean-Pierre, deux militants brièvement croisés ne
tardèrent d’ailleurs pas à lui préférer Aix-en-Provence. Nous
étions donc Michèle et Jean-Marie D. sur le front SNCF, Danièle et
moi sur le front immigrés, à qui s’ajoutaient Juliette chez qui
habitait Danièle, les amis Ève-Marie et Robert B., l’anarchiste
Jacques B., un peu plus tard les très jeunes Denis et Jean-Pierre
venus de Nîmes pour nous épauler. À la périphérie, plus ou moins
proches, les progressistes comme on les appelait : Marie-Thé et Max
L., Élisabeth Barbier la célèbre auteure des “Gens de Mogador”,
des amis du PSU, un prêtre même chez qui nous ronéotypions nos
tracts. Qui d’autre ?... Raymond Marcellin n’avait vraiment rien
à craindre d’un petit groupe aussi éloigné et aussi informel.
Néanmoins nous
mettions du cœur à l’ouvrage : diffusions de tracts et de
journaux sur le marché dominical, réunions nocturnes au rocher des
Doms, réunions sur les conditions de logement que faisaient
marchands de sommeil et marchands de travail à nos amis Tayeb,
Houcine, Djelloul, Belkacem, Allaoua et aux autres (le marché aux
esclaves de Carpentras pour mémoire), rendez-vous le midi à la
Pyramide où les invendus du marché gare constituaient le menu qui
nous était servi, le soir rue Pavot chez Juliette et Danièle :
Juliette qui avait vécu en Argentine nous chantait des chansons du
Cuarteto Cedrón, de Paco Ibanez ou des chants révolutionnaires en
s’accompagnant à la guitare. Du côté militant ou du côté
bohème, je ne sais lequel des deux prévalait. Robert bombant sur
les murs du lycée quelque chose comme “L’école me vole mon
amour !”, Max me faisant découvrir John Coltrane et Bram Van
Velde, Denis, Jean-Pierre et moi discutant longuement de L. F. Céline
ou de Nietzsche de préférence à Karl Marx ou Mao... Il nous arriva
quand même de nous achopper à la question de Staline qui faisait
partie d’une panoplie prochinoise dont nous ne tenions pas à ce
qu’elle nous collât à la peau : les prochinois labellisés
étaient les marxistes-léninistes du PCMLF, pas nous. Une fois, nous
fûmes conviés à une grande réunion interne à Marseille, tout ce
que la Provence-Côte d’azur comptait de maos était rancardé sur
je ne sais plus quelle place, à tel point qu’il me sembla n’y
avoir que nous aux différentes terrasses de cafés avant qu’on ne
nous récupérât pour nous mener vers le lieu tenu secret de notre
réunion. Nous, Avignonnais, avions notamment à y faire part de nos
doléances. Mais on ne nous donna pas la parole. Un cadre venu de
Paris, Eusèbe (pseudonyme de Jacques-Alain Miller) occupa les
trois-quarts du temps à descendre deux militants présents qui
avaient rompu avec le PCMLF afin de nous rejoindre. Après que nous
n’eûmes rien compris à cette exécution, nous regagnâmes nos
pénates, une messe avait été dite. Ce fond de l’air non exempt
de toute candeur, ce que nous avons pu l’arpenter ! Danièle que
nous n’appelions pas encore par son diminutif avait pris la douce
habitude de venir me réveiller dans mon meublé, elle me préparait
une tasse de café avant que de nous remettre à notre grande
aventure. Ah... vignon ! Ah... voir vingt-deux ans à... vignon !
Arriva ce qui devait arriver, un midi nous finîmes par nous pointer
main dans la main à “La Pyramide”, ce qui loin d’étonner nos
amis en amusa quelques-uns, je crois bien : la veille au soir elle
m’avait invité à partager un riz indien dont elle tenait la
recette d’authentiques orientalistes londoniens, et nous avions
décrété qu’à nous deux il n’y avait pas mieux. Je quittai
donc la rue Banasterie pour rejoindre nos quartiers dans son petit
deux pièces de la rue Sureau. Dans la foulée je quittai la
Compagnie fruitière pour un chantier du côté d’Uzès, puis ce
chantier pour la manutention chez Berton et Sicard où le
tire-au-flanc occupait le plus clair de son temps à guetter le
passage du contremaître, puis Berton et Sicard pour les alvéoles de
Gattini que dirigeait un sombre esclavagiste, puis Gattini pour la
cave coopérative de la Barthelasse pour décuver le marc, puis la
cave de la Barthelasse pour la Sitpa où je me fis laborantin... De
son côté Dan quittait la fac pour Rolli, puis Rolli pour Liebig,
puis Liebig pour Buitoni, et encore Buitoni pour la fabrication à la
chaîne d’alvéoles chez ce même Gattini. De travaux intérimaires
en travaux saisonniers le cycle de l’emploi avait tout d’une vis
sans fin. Notre mariage, fin octobre 1972 après qu’Henri B. en eût
délivré l’augure donnait droit à deux jours de congé, mais
c’est le mois entier que nous nous octroyâmes. Fin novembre, mon
solde de tout compte m’attendait déjà depuis un bon moment.

Stan Webb (Chicken Shack)
~ 21 ~
À
la lecture, cette succession d’évènements semblera rapide, on
peut dire qu’elle le fut plus qu’il n’en faut pour l’écrire.
Nous nous sommes mariés civilement au bout de cinq mois, Dan en
costume de velours noir, moi avec costume beige et bottes d’officier
allemand. Les parents de Dan avaient organisé un lunch dans un
caboulot au bout de la rue Carreterie, y vinrent ma mère et Francis
D. qui avaient fait le voyage de Lille, Henri B., Michèle et
Jean-Marie D., quelques amis et voisins pour ce dont je me souviens,
et que ce fut en toute intimité. Je n’ai même pas eu le temps de
dire que de la rue Sureau nous déménageâmes pour la rue
Carreterie. Une belle grande pièce du XIVe siècle solidaire du
clocher des Grands Augustins et compartimentée en chambre, cuisine
et salle à manger surplombée d’une ogive. Un petit balcon aussi.
Et une fois dehors la belle place des Carmes. Moi qui aime tant
photographier, je m’étonne d’avoir si peu mis à contribution
mon RevueFlex. Le coût des tirages était assez prohibitif, il est
vrai. En septembre 72 nous rencontrâmes tout à fait incidemment
Olivier descendu de Paris pour le festival. Olivier venait juste de
faire la connaissance de Micheline qu’il allait épouser quelque
temps plus tard...
Le rock étant le
référent de cette véritable histoire, revenons donc au rock, même
si c’est pour mieux digresser. Cette année-là, un jeune collègue
de travail nous prêta des disques qui ne furent pas peu des
découvertes : Roxy Music dont les deux premiers LPs étaient tout
chauds, Alice Cooper dont le “Love It to Death” n’avait pas
vraiment eu le temps non plus de refroidir et Cactus. Pour commencer
et pour le côté classieux, Roxy Music que je rattachai
immédiatement aux musiques pop et soul des 60’s, avec le petit
quelque chose en plus qui prenait grand soin d’éviter l’écueil
de la banalité. Classique et novateur juste ce qu’il fallait :
bien vu. Avec son rock’n’roll musclé, Alice Cooper, que nous
vîmes en concert à l’occasion de la sortie de “Special forces”,
dix ans plus tard, était tout aussi excitant. Quelle veine
prolongeait-il ? Who ? Gun ? MC 5 ? Steppenwolf ? Sa musique était
du genre qui tape fort, ce qui n’était pas rédhibitoire, mais là
aussi avec quelque chose en plus, ou en mieux, et pourtant je n’avais
pas encore eu l’occasion d’apprécier ses ressources théâtrales
déployées sur scène. Avec ses musiciens venant de chez Frank
Zappa, le son ne manquait pas d’annoncer la couleur. Quant à
Cactus qui était au Vanilla Fudge ce que Mr Hyde est au Dr Jekyll,
et que je rangeai dans le fourre-tout hard rock, il m’interpella
moins, le côté “c’est moi que v’là”, sans doute...
Avez-vous remarqué
qu’il est très rare qu’un amateur de rock aime la soul, qu’un
amateur de Sam Cooke aime l’art lyrique, qu’un amateur de Richard
Wagner aime la musique arabe, qu’un amateur de raï aime le jazz,
qu’un amateur de Miles Davis aime le kayagum sanjo, qu’un amateur
de kayagum sanjo la pop music, qu’un amateur de pop la musique
africaine, qu’un amateur de musique africaine le tango argentin,
qu’un amateur de tango le death metal, qu’un amateur de Slayer la
musique mongole, qu’un amateur de khöömii le blues, etc. Pour ne
rien dire des chauvinismes nationaux, régionaux et même cantonaux.
L’identité musicale est aussi un indicateur des craintes de ce
monde, des fois que la rencontre de l’une avec l’autre
occasionnerait un arc électrique. Quoiqu’elle ne soit pas audible
au premier coup d’oreille, la consanguinité dans le gaz à quoi
encourage l’industrie musicale affecte la plus grande partie du
neurone humain, la production de la rareté étant la contrepartie
perverse des brouets déshydratés donnés à la masse. Musicalement
parlant, je suis un pervers polymorphe, je change de disque.
Récemment, j’ai visionné une interview de Salvador Dali qui,
après André Breton et Paul Éluard, explique pourquoi il n’aime
pas la musique : “En musique, on ne peut rien dire de concret. On
ne peut même pas dire : « Allez, soyez gentil, me chercher le
chapeau que j’ai laissé là-bas »”, et il poursuit à propos du
besoin de “s’appauvrir le plus possible, de se limiter au maximum
pour arriver au paroxysme de certaines idées”. Je conçois
d’autant plus que le paroxysme de certaines idées ne soit pas
soluble dans la distraction que je ne peux écrire avec un fond
musical, il n’en demeure pas moins qu’inversement l’apnée des
idées s’appelle idée fixe. M’étant interrogé sur le sentiment
qu’Henri Michaux avait bien pu éprouver envers la musique, lui qui
avait également exprimé sa hantise de se laisser distraire et dont
ne m’étonna pas qu’il ait commencé par la trouver aliénante,
voire haïssable : “je comprenais, je croyais comprendre,
intérieurement et rétrospectivement, ce qui attire les foules et
qui m’avait toujours paru tellement inepte. « Leur » musique”,
je m’aperçus que c’est de l’amour que peu à peu il finit par
la rapprocher. À vrai dire, c’eut été plus qu’étonnant qu’à
la longue il ne trouvât pas le passage. Ce crochet par l’auteur
d’“Un Barbare en Asie” a probablement valeur d’intercession
pour la musique orientale venue me rappeler une chose qui n’est
plus évidente pour qui que ce soit : qu’au contraire d’être la
diarrhée pandémique que nous entendons partout et quelle que soit
l’heure sans jamais faire retour au choc émotionnel qui fut le
nôtre quand nos oreilles commencèrent à s’ouvrir, la musique est
une chose étrange, littéralement extraordinaire, avec laquelle nous
dûmes d’abord avoir, quoique nous l’ayons oublié, une sorte de
rapport ésotérique. Dire que nous l’avons banalisée est
tellement peu dire. Nous en avons fait une chose grasse, Michaux
dirait “collante”, ou “poisseuse”, grasse comme ces frites
dont les festivals se repaissent. Sait-on bien si c’est elle que
fêtent les festivals ou les fricadelles sauce samouraï ? Et si une
certaine ivresse doit en découler, il est curieux que ce soit, de
préférence aux pincettes, avec des doigts odorants de piccalilli.
Ce qu’on s’amuse, par Jupiler !

Henry Vestine (Canned Heat)
~ 22 ~
Plumé,
déplumé le bestiau ! Après avoir quelque peu renoué avec lui via
Roxy Music et Alice Cooper, il fallait bien que je trouvasse qu’il
était aussi spécifiquement dans l’appât du grain que dans le
rock, aucune poule n’a jamais trouvé de cure-dents sans eurêka.
N’eût-il eu que la fortune d’être corned aurochs dans la
gidouille, il n’en eût pas moins cultivé la sinécure.
Sociétalement parlant, son antalgique saga n’échappait à rien,
pouvait être de mèche avec à peu près tout. Du point de vue de
l’enseignement ce n’est pas un moindre désavantage mais c’est
intéressant quand pour être in il suffisait de savoir que ce sur
quoi on avait le cul s’appelait rocking-chair (“I’m gonna hold
my baby as tight as I can / Tonight she’ll know I’m a mighty,
mighty man / I heard the news, there’s rocking-chair tonight”),
du mot rock qui vient de rocca via le français roc (“Oh ! que la
mer est sombre au pied des rocs sinistres !”, Victor Hugo). Du
temps où le rock n’était pas encore histoire de famille
avec cousin d’Amérique plein aux as et neveux wazemmois au RSA, il
en allait autrement, mais depuis cette époque je me suis mis à
abonder dans un sens fait d’hybridité réjouie et de confusion des
genres. Ainsi après avoir dit de Frehel et de Piaf qu’elles
étaient nos blueswomen, de Berlioz un Chuck Berry au grand pied,
lui-même redevable à Beethoven comme Beethoven à Kubrick, je
propose qu’Esquerita donne la réplique à Florence Foster Jenkins
dans un remake de “Sons and lovers”.
Je raccrochai, var.
je décrochai. Il n’y a pas que la confusion mentale des genres et
l’hybridité débridée, il y a aussi l’embrouillamini de la
langue. Nonobstant Paul Éluard, je me garderais bien de prétendre
qu’on peut tout dire. Il y en a suffisamment qui ont estimé aux
dépens des autres que ce n’était jamais assez, pour se tenir à
carreau. On ne peut pas tout dire. Moi, je ne le peux pas, le corps
de la langue peut bien être en expansion infinie les directions
étroites qu’emprunte l’expression résultent de choix. Dire que
le rock n’est pas dans le rock n’est pas suffisamment dire à
quel point il a cessé d’atteindre au rock qui est plus grand que
lui. Comprenons bien : tant de choses devraient être dans ce qui les
excède, là je dis “rock” parce que ce mot me permet d’entendre
ou d’atteindre d’autres choses : la poésie, la politique, l’art,
le cinéma, que l’érosion naturelle finit fatalement par
transformer en bibelots ou en colifichets. Tant de choses ne
parviendraient à elles-mêmes qu’en devenant la contrepartie de ce
qui les excède. Nous avons perdu de vue qu’il y a des choses non
pas plus grandes que nous, cela est la plupart du temps très
abstrait, mais des choses trop grandes pour nous, trop grandes pour
nos petits bras, trop grandes pour nos petites oreilles, pour nos
petits yeux, pour notre petite conscience, pour notre petite langue,
pour notre petite énergie, pour notre petite curiosité, pour notre
petit monde, pour notre petite ferveur. Que des choses nous dépassent
ne signifie pas qu’elles sont incompréhensibles, ou énigmatiques,
ou transcendantes, plutôt qu’elles font renaître en nous la
sensation d’altitude, la dimension proprement vertigineuse de la
vie.
À la fin de l’été 73,
ayant quitté Avignon pour tenter notre chance dans le Nord, c’est
d’abord à Lille que nous débarquâmes. Pour commencer nous
logeâmes rue du Puebla au-dessus d’une blanchisserie dont le
propriétaire ne pouvait pas nous croiser sans nous alpaguer au sujet
de ses ancêtres de haute lignée : Charles Quint, Henri IV ou
Napoléon III, tous étaient de la famille, “Point de vue” et
“Jours de France” à l’appui ! Notre voisine de palier, elle,
était une alcoolique invétérée qui n’arrêtait pas d’houspiller
son adolescente de fille, au point qu’un jour, courant après elle un couteau à lal main,
toutes deux pénétrèrent en coup de vent dans notre appartement,
enjambèrent notre lit tandis que nous dormions et disparurent comme
elles étaient arrivées. Très vite, je fus embauché à la Poste
qui était aussi une fabrique de personnages hauts en couleur,
beaucoup d’entre eux démolis par la dureté du travail, car au fil
du temps et des sacoches pleines à craquer le métier de facteur
devient très dur, mais aussi par la boisson. Le tri du courrier le
matin était une foire aux délires, ici l’ancien légionnaire qui
mettait la main au paquet des collègues et particulièrement de ceux
qui n’entendaient pas se laisser faire, tel autre qui à raison
d’une semaine de bitures par mois venait dormir sur sa table de tri
au lieu de rentrer chez lui, beaucoup parmi eux étaient des cas de
figures. Exception faite du délégué CGT et d’Émile. Émile
était un petit bonhomme ne payant pas de mine à côté de qui il
m’arrivait de faire le tri du matin. J’aimais bien parce que nous
parlions toujours opéra. Une fois, il m’avoua qu’il était de
droite, façon de dire qu’il n’était pas comme les autres. Ne
pas être comme les autres, au travail, c’est souvent être seul,
et parfois prêter le flanc à leur cruauté. Il faut être sur ses
gardes. Chez Gattini, un jeune manutentionnaire avait eu la
maladresse de déclarer qu’il écrivait des poèmes. À compter de
ce jour il devint la risée de tous, et du “Poète” par-ci, et du
“Poète” par-là. Je sais pour l’avoir constaté que dans une
relation de proximité le poète, appelons-le comme ça, est
quelqu’un qui provoque de la gêne. Les rieurs, les gênés aux
entournures, je n’ai jamais supporté.

Omar Kent Dykes (Omar and the Howlers)
|~ 23 ~
Facteur,
j’ai principalement écumé le quartier des 400 Maisons, à
Lille-Sud, où vivaient de nombreux retraités, ce qui voulait dire
qu’à l’heure du versement des pensions de retraites je partais
chaque matin avec en sacoche, outre le courrier, quelque chose comme
un million de francs en liquide (environ 9000 €). C’était dingue
! À peine avais-je été embauché comme auxiliaire qu’on
m’envoyait à Lille-Sud avec sur moi de quoi décrocher la timbale
si on s’était avisé de me détrousser. La tournée des 400
Maisons rapportait énormément de pourboires au préposé qui
assurait la distribution du courrier — la générosité de la
classe ouvrière est légendaire — aussi était-elle très
convoitée lors de la redistribution annuelle des tournées. Le
bénéfice que je tirai du remplacement de son titulaire se
matérialisa en disques d’opéras que ma tournée terminée
j’achetais chez Maxi Machin-Truc, rue de Béthune. L’alcoolisme
eût pu être le danger, heureusement que je ne restai pas assez
longtemps dans le métier pour y sombrer. En effet, à chaque mandat
versé, outre le pourboire les gens tenaient à ce que je trinque
avec eux. J’avais beau m’excuser en disant que j’avais déjà
trinqué dans la maison précédente, rien n’y faisait. Pas cons,
les processus, qui font de l’ivresse un avatar de votre
libre-arbitre ! Je pense à ce vieux couple qui débouchait à chaque
fois une bouteille de Bordeaux. Les gens, les gens qu’on appelle
les gens, sont comme ça, et même parfois ils sont enclins à plus
d’intimité que cela. Le facteur que je remplaçais avait sa
maîtresse sur cette tournée, il n’était pas le seul.
Moi, ma maîtresse
c’est la musique. “... que j’aime, et qui m’aime / Et qui
n’est, chaque fois, ni tout à fait la même / Ni tout à fait une
autre...”. Une histoire d’amour qui n’est pas éprouvée sur le
mode soudain du frisson ne peut répondre que de succédanés.
Par-delà les “j’aime/j’aime pas” de routine (cf. Beatles vs
Rolling Stones, Callas vs Tebaldi, pop music vs rock’n’roll,
etc.), il y a l’émoi, la vibration qui vous parcourt l’échine,
la “good vibration” comme ont chanté les Beach Boys. J’ai eu
la chair de poule avec des musiques qui n’avaient rien de commun
entre elles, pourtant chacune de ces musiques était toujours
l’invariable variante de l’autre. Dans le fond, le reflux que je
trouvais maintenant au rock n’était pas indifférent à ce que
commençaient à en percevoir les musiciens de pub rock et plus tard
les groupes punks. Tant du côté du rock progressif, que du jazz
rock, que du hard rock, que du disco, que du glam rock, ça enflait,
ça gonflait, ça devenait bibendumesque et pour tout dire grand
public. Grand public, comme on dit “opinion publique”. Les
regards de bien des fans d’hier se mirent à lorgner du côté du
blues américain, à l’époque moins consensuel. C’est aussi à
ce moment-là que j’ai acheté mes premiers disques de blues,
cependant que pour l’essentiel c’est vers l’opéra que je me
tournai. Si les soi-disant trente glorieuses n’ont pas eu
d’incidence en tant que trente glorieuses sur ma vie privée,
j’accorde néanmoins que l’histoire du rock coïncida avec ces
trois décennies : première décennie incisive-subversive, seconde
décennie inventive-intuitive, troisième décennie
triomphaliste-présomptueuse. Mais, encore une fois, je ne m’y
intéressais pas et tout de ce sur quoi j’avais fait l’impasse
depuis Berlin n’advint qu’une dizaine d’années plus tard.
Cette troisième décennie qui, pour peu que l’on fît sien le pas
de côté prescrit par “L’An 01” (le film de Jacques Doillon en
cette même année 73) allait s’avérer des plus fécondes, n’a
jamais manqué de me laisser sur un sentiment ambivalent.
Coupant court à l'entretien d'embauche de Dan en hôtesse d’accueil
à l’aéroport de Lesquin, l’Éducation Nationale lui proposa un poste de maîtresse-auxiliaire d’anglais, de français et de musique à Bourbourg, commune de
7300 habitants sise à 20 bornes de Dunkerque. Nomination qui m’évita
opportunément l’alcoolisme que j’avais cru au menu du parcours
professionnel du parfait facteur. C’est dans un deux pièces de la
place du Marché aux chevaux que nous nous préservâmes des embruns
de la mer du Nord toute proche. Tout proche également, le carillon
mélancolique de l’église Saint-Jean-Baptiste. Je passai mes
journées à peindre de ces choses abstraites sans lesquelles point
de noviciat et me serais bien gardé de jurer que l’euphorie, au
moins elle, fût loin du but. Ce dut être la contrainte du peu de
place, un coin de table, qui l’année terminée remit le charme à
plus tard. Au demeurant nous en étions très vite venus à accuser
de mortel ennui cette petite ville pourtant bien innocente et à
refaire régulièrement la route de Lille avec cette satanée 2 CV
qui ne démarrait jamais et que chaque matin il me fallait pousser.
C’est sur la route de Dunkerque qu’un jour nous prîmes avec nous
une vieille dame qui faisait du stop. Cette dame qui ne craignait pas
de ne se déplacer que de cette façon y enseignait le chant et en
moins de temps qu’il n’en fallait pour être rendu à destination
nous devînmes ses élèves.

Lonnie Mack
~ 24 ~
Olga
était son prénom. Olga D. La crinière blanche et drue comme le caractère
qu’elle affirmait haut et fort être celui d’une Flamande. Veuve
de guerre, elle habitait à Hazebrouck, une ville dont je me suis
toujours demandé si elle existait vraiment. Elle me donna des cours
de chant deux ans durant mais quoiqu’elle me pressentît pour le
concours d’entrée au Conservatoire de Lille je me demande si le
plus important n’était pas que nous fussions l’un à l’autre
nos petits grains de folie respectifs. Le sien pouvait consister à
attraper un ou deux pigeons, Dieu sait au prix de quelles acrobaties,
du haut du carillon de l’église Saint-Éloi dont elle était
titulaire. Très vieille France, mais anticonformiste comme savent
l’être certains aristos, elle aimait l’art lyrique à la façon
des professeurs, pour l’enseigner, non en mélomane. Une fois nous
eûmes le plaisir de la convier à une représentation de la Tosca à
l’Opéra de Lille. Et naturellement, le moment venu elle ne put se
retenir de murmurer “Vissi d’arte / Vissi d’arte, vissi
d’amore, / non feci mai male ad anima viva ! / Con man furtiva /
quante miserie conobbi aiutai. / Sempre con fè sincera / la mia
preghiera / ai santi tabernacoli salì...”, l’air de bravoure.
Nous voilà en 1974,
Valéry Giscard d’Estaing élu président en mai. Avant de passer
de Bourbourg à Saint-Omer, il y eut avec Olivier et Micheline B., le
frère de Micheline et sa femme, l’été en Haute-Provence, à
Mézel ! Mézel, et autour Majastres, la Palud, le lac de
Serre-Ponçon, La Batie, Estoublon, l’Estoublaisse et son eau
jaillissante, le marché de Digne, la Bléone et tout là-haut
Châteauneuf-lès-Moustiers et son berger. Comme l’évocation de
ces noms maintenant si lointains me ravit ! Il faisait très beau,
c’était lumineux, limpide, de cette dimension solaire que dans la
grisaille de nos villes on nous avait appris à méconnaître. Sur
place, nous n’arrêtâmes pas d’écumer le pays, de grimper,
d’escalader même, de nous régaler de plats de saison et de
beaucoup discuter. Discuter politique bien sûr, et filant le train à
la politique de quelque chose qui allait devenir de toute première
importance pour Olivier et pour moi : la possibilité d’entreprendre
des études. Pas n’importe quelles études : des études en fac’,
devenir étudiants. Olivier qui comme moi n’avait pas le
baccalauréat était déjà inscrit à l’université de Vincennes
Paris VIII à laquelle les non-bacheliers pouvaient accéder.
Était-ce possible ? Dix ans durant ce fut possible ! Pour moi qui
avais toujours été jaloux des étudiants, et particulièrement lors
de l’épisode du théâtre l’U1 où Eugène et moi étions censés
restaurer la culture bourgeoise, je peux bien le dire, c’était une
chance de sortir d’une ornière dans laquelle je n’avais été
que trop confiné, une révélation, une aubaine. Dan m’engagea
vivement à ce que je m’inscrivisse, ce que j’allais faire dès
que nous serions remontés.
Rentrés à
Bourbourg, Dan apprit sa mutation à Fauquembergues, à une petite
cinquantaine de kms de Bourbourg : route pas facile, il était
impératif de déménager. Le jour de la rentrée elle me largua à
mi-chemin, à Saint-Omer, où je lui promis que le soir, quand elle
me reprendrait au passage j’aurais trouvé de quoi nous loger, et
c’est là où la liste des rencontres fortuites à Paris
précédemment allait s’allonger. Je n’étais pas descendu de la
voiture de trente minutes que je tombai sur un pote d’armée,
Dominique D. à qui, à nouveau, je racontai mon histoire. Ça ne
s’invente pas ! Ni une ni deux, lui et moi allâmes trouver son
père qui tenait un commerce rue Carnot et, coup de pot, Mr D. père,
propriétaire d’un fonds de commerce dont il n’avait pas l’usage,
rue Louis Martel, consentit à nous le louer. Nous n’eûmes jamais
la certitude que le rideau tendu derrière la vitrine fût
suffisamment épais pour ne pas offrir un théâtre d’ombres le
soir venu. Dominique D. était un très bon guitariste qui, à la
différence de Jimi Hendrix gaucher comme lui, n’avait jamais
inversé les cordes de sa guitare. Ultérieurement, il se fit
disquaire dans le magasin d’électroménager du père — disques
de rock, bien entendu — où il donna également des cours de
guitare. Saint-Omer, 15 000 habitants, ne retint pas plus notre
attention que Bourbourg précédemment, et c’est un fait que pour
qui la vie excentrée est source de mélancolie, cette ville n’était
pas d’élection. Pourtant, en 1974-75, n’étant pas envahi de
voitures comme les grandes villes le sont de nos jours, Saint-Omer
était plutôt photogénique. Maintenant que les villes moyennes se
vident de tout ce qui faisait leur qualité de vie, il me semble
qu’une inclination patrimoniale à la lenteur et à ce qu’il faut
de noble austérité pour séjourner dans ses pensées, ce qui peut
s’appeler “un certain charme”, étaient à mettre à son actif.

Captain Sensible (The Damned)
~ 25 ~
En
juillet 1975, nous passâmes à nouveau nos vacances en
Haute-Provence, à Chavailles, avec Olivier, Micheline, son frère
Bernard et sa femme, Patricia B. l’amie vincennoise qui s’extasia
sur la petite araignée verte au plafond au-dessus de son lit, un
soir avant de s’endormir, et se réveilla le lendemain cruellement
piquée. C’est l’album photo qui atteste maintenant la date
écrite au crayon de bois, sinon je serais bien incapable de fixer
quoi que ce soit. Si ce n’est que de dire que comme l’année
précédente et contrairement à l’interlude avignonnais ma
relation avec Olivier avait repris le cours normal d’une bonne relation
amicale, je n’arrive pas à déterrer d’anecdotes, ces photos ne
me sont pas devenues étrangères mais elles ne m’évoquent plus
grand-chose, ici notre petit groupe sur un chemin, là en train de
pique-niquer au sommet d’une montagne... Il y a quand même cette
anecdote-ci, dans la bergerie de Châteauneuf-lès-Moustiers à
l’issue de notre mois de vacances, à moins que ce ne fût l’été
74. Nous courons en tous sens afin d’étouffer un début de feu
d’herbes rases qui se propage à toute vitesse. Le trou que nous
avons fait pour brûler nos déchets n’a pas été suffisamment
dégagé. C’est effrayant une telle vitesse, aussi courons-nous
encore et encore en tous sens avec nos couvertures pour frapper
l’herbe. Et quand c’est fini d’un côté, la moindre petite
flammèche pas tout à fait étouffée repart de l’autre. Nous
courons jusqu’à ce que je finisse par valdinguer et me fouler la
cheville. Heureusement le début d’incendie n’a pas excédé une
ou deux dizaines de mètres carrés, la montagne est sauve et notre
conscience aussi est sauve. Pour ce qui est de la cheville nous
verrons ça dans un jour ou deux avec le rebouteux de
Saint-Étienne-du-Grès.
Saint-Étienne-du-Grès,
village natal de Dan, entre Tarascon et Saint-Rémy-de Provence, à
l’extrémité des Alpilles. Les deux routes départementales qui
l’enchâssent se rencontrent au marché où convergent chaque
semaine les agriculteurs de la région, dont Ottorino, le père de
Dan, avec son chargement de melons, haricots et autres tomates bien
juteuses. Suzanne et lui sont ouvriers agricoles, les grands-parents
de Dan qui ont fui l’Italie mussolinienne vivent et travaillent
aussi avec eux. C’est un dur travail que le travail de champs, et
quand il faut ramasser les haricots je me révèle illico comme étant
le plus empoté de tous... Il y a si longtemps. J’aimais la route
étroite, sinueuse, ombragée qui menait à “La Souleïado”, leur
maison au flanc des Alpilles. Aujourd’hui elle est large, droite et
sans arbres, les voitures peuvent y rouler vite. J’aimais marcher
le long de la roubine, avoir la chance, parfois, de rencontrer un
serpent. En rentrant de Chavailles nous étant empressés de nous
rancarder avec le rebouteux, il accepta que notre petit groupe
curieux de le voir travailler ma cheville prît place dans sa salle à
manger. Ses manipulations qui durèrent une bonne demi-heure voire
une petite heure nous impressionnèrent, lui-même avait très chaud.
Deux jours plus tard, ma cheville avait désenflé et perdu son
violacé, je pouvais marcher comme à l’accoutumée. L’expérience
m’avait-elle plu à ce point qu’un an ou deux plus tard en
travaillant aux champs avec mes beaux-parents ma cheville crut bon de
récidiver ?
Saint-Étienne-du-Grès
c’est aussi le temps de l’amitié autour d’une table, les soirs
d’été, en train de galéjer, de nous disputer les vertus
respectives de tel ou tel millésime du Pommard ou celles du
roquefort “Papillon” contre le roquefort “Société” : Alain
et Maryse A., Sandrine leur fille, Jeannot B., Louis A., Suzanne,
Jeannot R., André B. le caviste, Lucile sa femme, David et Jean-Guy
leurs deux fils, Riri, le père André, etc. : raconter des histoires
eussent-elles déjà été dites et redites, parler pour le plaisir,
rire aux éclats, tout cela était à soi seul un régal. Dire que
c’était le bon temps ne signifie pas que ce temps était meilleur
qu’aujourd’hui, seulement que l’ébarbage temporel a le pouvoir
d’irréaliser, ou d’idéaliser, en focalisant ce qui fut.
Peut-être faut-il même que la vue ait baissé pour en juger. Les
couleurs ont passé, les bruits sont devenus silencieux, les visages
se sont évanouis. Le vrai bon temps c’est celui dont on peut dire
“celui-là, c’est le bon”, qui, en demi-teinte, à voix basse,
dit pour lui-même : “C’était le bon temps”, c’est celui qui
reste.

Albert King
~ 26 ~
Vincennes
commençait, au sortir de la bouche de métro, avec l’imposant
château au pied duquel convergeaient les lignes d’autobus dont
celle qui desservait la fac à une bonne dizaine de minutes, me
semble-t-il, tout là-bas au fond du bois. À pied ça devait faire
une petite demi-heure, mais en contrepartie ça permettait de mater
les péripatéticiennes. Une fois dans la fac, les épaisses couches
d’affiches offraient un véritable topoguide des strates
politiques. C’est François Châtelet en grande discussion avec
René Shérer qui me reçut et, me tapant sur l’épaule en me
souhaitant bonne chance, valida mon inscription dans le département
philosophie. L’obtention de la licence maison nécessitait 30
unités de valeur, quelle que fût la durée pour y parvenir, 20
unités dans le département où l’on était inscrit et 10 où l’on
voulait afin de parfaire sa culture générale. Cette règle valant
pour tous les départements, je m’inscrivis au département de
littérature française où aux 20 ici aussi il me suffisait
d’ajouter 10 unités de valeur en philosophie, ce qui par le jeu du
cumul me donnait la possibilité d’envisager deux licences en 40
unités de valeur. Je fis hebdomadairement la navette
Saint-Omer-Paris, à raison de 3 jours sur Paris, un an durant.
Ensuite Lille-Paris jusqu’en 1979.
Cette première
année, je créchai dans une cave poussiéreuse à
Champigny-sur-Marne, un lit de camp et puis c’est tout.
Heureusement, le matin je pouvais me débarbouiller dans l’appart’
en coloc’ du gars et des deux filles qui étaient censés me la
louer. En réalité, ils durent estimer que cette cave était
suffisamment insalubre pour me dispenser de toute quote-part. À la
fac, le département philosophie était à un bout d’un long
couloir, le département littérature française à l’autre bout,
c’était très pratique. Ces deux départements n’avaient pas
exactement le même régime, le département philosophie préparait à
une licence qui n’était pas reconnue tandis que la licence à quoi
préparait le département de littérature française était validée
si l’on suivait un cursus à vrai dire fort peu contraignant :
trois unités de valeur dites d’introduction aux études
littéraires, une d’introduction à la linguistique dans le
département de linguistique et une de langue étrangère qui me fit
choisir le tupi-guarani avec le poète paraguayen Rubén Bareiro
Saguier dans le département d’espagnol.
Vincennes était-il
un haut lieu de scandale ? En février “Le Nouvel Observateur”
fit paraître un numéro retentissant sur des travaux pratiques de
sexologie nécessitant la location d’un hôtel parisien. Ce numéro
laissait-il entendre que l’Université française s’adonnait au
sexe ? Il me sembla que beaucoup l’entendirent ainsi. Le sulfureux
département des Sciences de l’éducation où officiait Georges
Lapassade, provocateur de haute lignée, devait être derrière cette
affaire-là. J’ai le souvenir d’un cours avec Jacques Rancière
devenu impossible à suivre à cause du tintamarre qui venait de la
salle voisine. Nous nous y rendîmes : sous la houlette de Georges
Lapassade des étudiants torse nu dansaient au rythme d’une
percussion, criaient et se reniflaient les uns les autres. C’était
assez hallucinant et maintenant que je revois la scène je ne puis
m’empêcher de rire intérieurement d’un rire joyeux.
Vincennes était une telle fabrique de tolérance, d’intelligence,
d’expérimentations, d’inventions, qu’aujourd’hui cela
provoquerait une levée de boucliers. Une république dans la
République, une vie en ébullition perpétuelle avec assemblées
générales à propos de tout et à tout bout de champ, et de
superbes moments de délire qui loin de fracturer la communauté
estudiantine édifiait au contraire sa demeure. Cet étudiant
africain, par exemple, qui en pleine A. G., excédé, quitta l’amphi
en criant “je prends la porte”. Et effectivement, après avoir
entendu un fort bruit provenant d’une salle voisine, nous le vîmes
revenir au bout de quelques minutes avec une porte qu’il
brandissait à bout de bras. Il y avait du Mouna Aguigui dans ce
genre de démonstrations. J’ai en vue du même tonneau dans les
cours de Gilles Deleuze, Félix Guattari tâchant de contenir au
mieux la grogne qui, au bout de deux heures de délire d’une
étudiante, finissait par gagner, ou dans celui de François Châtelet
dont les étudiants s’apprêtaient à sortir manu militari les
trotskystes de l’OCI venus les sommer de les suivre en manif. Le
département de philosophie était un centre de gravité politique de
la vie vincennoise qui chaque semaine apportait son lot de surprises.
Le bordel, oui, mais jamais n’importe quel bordel.
Le département de
littérature française où je retrouvais chaque semaine Olivier
devenu dans l’intervalle agent de bibliothèque à Orléans,
c’était autre chose. Autant le département de philosophie était
tonitruant et volontiers volcanique, autant celui-ci était studieux
: Jean-Pierre Richard, Jeannine Jallat, Jean Levaillant, Ludovic Janvier, Jean-Michel Rey,
Jean-Claude Mathieu, Sami Naïr, ou Michel Deguy auteur de cette
sentence que j’ai déjà beaucoup rapportée : “Et là-bas, au
bout du couloir, il y a un monsieur (Gilles Deleuze) qui dit « Freud
on s’en tape le cul »”, etc., assuraient la bonne mesure. “...
La nuance seule fiance / Le rêve au rêve et la flûte au cor !”,
celle-ci née de l’alternance entre un bout du couloir et l’autre
bout diamétralement opposé, mais pas seulement, me convenait on ne
peut mieux.
Dave Gonzales (The Paladins ; Hacienda Brothers)
~ 27 ~
Après
la cessation d’activités de La Cause du Peuple en novembre 73,
dissolution que je n’avais pas attendue pour me retirer, Dan et moi
participâmes à diverses manifestations politiques, contre la
centrale nucléaire de Gravelines toute proche, contre Joël Dupuy de
Méry, dit sergent Dupuy, ou contre les Houillères avec le Tribunal
Populaire de Liévin organisé par le groupe Front Rouge après la
catastrophe minière qui emporta quarante-deux mineurs à la fosse
des Six-Sillons le 27 décembre 1974. Le groupe Front Rouge, du nom
de son journal, était une scission du PCMLF (maoïste, reconnu par
Pékin), son action en faveur d’un tribunal populaire à Liévin
reprenant la formule du Tribunal Populaire de Lens mené par la
Gauche prolétarienne en décembre 1970 nous sembla un gage et nous
donna à penser que nous tenions là un groupe enfin capable passer
de la parole aux actes ou, en langage militant, de la théorie à la
pratique. La vieille empreinte doctrinale voilait encore l’horizon
mais la ligne générale nous semblait porteuse. En avril 1974 ce
groupe devint PCR(ml) et “Front Rouge”, son journal, “Le
Quotidien du Peuple” lors d’un mémorable meeting à la Mutualité
cernée par les rivaux du PCMLF au grand complet et en tenue de
combat. J’allai à plusieurs reprises dans leur bunker parisien
faire des dessins pour leurs affiches mais les réflexes de
commissaires du peuple étant à la longue trop indélébiles pour ma
patience, et bien que j’y eusse rencontré des militants
estimables, Jacques L. à Béthune ou Félix à Lille, je m’éloignai.
Automne 75, entamant
ma seconde année d’études à Vincennes et m’y fis des amis
orphelins du maoïsme qu’un régalant bavardage n’insupportait
jamais, — de vraies encyclopédies. Ils suivaient les cours d’Alain
Badiou, à cette époque grand timonier de l’UCFML (autre groupe
maoïste) et moi ceux de Kostas Mavrakis (ancien de l’UJCML et
auteur de “Du trotskysme”). Olivier et moi parlions aussi de ces
choses quoique le virus lui fût passé. La fin des choses est aussi,
dans la mesure où dans bien des cas elle m’échappe, une chose. Une
autre chose et peut-être bien, de ce fait, une autre fin. La fin de
La Cause du peuple, on me dira que je n’avais qu’à être là, la
fin du PCR(ml), la fin du PCMLF, la fin du PSU, la fin des convictions
militantes de mon ami Olivier. Par quelles pirouettes met-on fin à
ce que cinq minutes plus tôt on affirmait avec une violente superbe ?
Plus précisément, comment ça se passe la fin d’une croyance ? Ce
n’est pas que les croyances ne doivent pas avoir de fin, seulement
comment ça se discute ? Au terme de quelles conclusions ? La fin
d’une histoire d’amour, ça je m’imagine. Ça peut être un
drame, ça n’en est pas moins une affaire privée, tandis que la
fin d’une entreprise militante, avec concepts, histoire, dogmes,
théories et surtout, j’ose l’espérer, responsabilités devant
les masses, c’est bien une affaire publique. Est-ce qu’il ne
suffit que de se barrer ? Benny Levy s’est barré en Israël, Alain
Geismar s’est barré au PS. Le PS grand récupérateur de tous ceux
de ces groupes, des maos aux trotskystes, qui prirent la poudre
d’escampette sans un mot d’excuse. L’histoire de cette
hémorragie n’est-elle pas intrigante ?
Dan fut affectée
pour quelques mois au lycée Alexandre Ribot à Saint-Omer, après
quoi elle entra début 76 à l’École Normale à Lille pour deux
ans. Nouveau départ et nouvelle installation, à Fives, rue du
Calvaire, où nous nous empressâmes de sacrer l’évènement s’il
faut en croire, neuf mois plus tard, la naissance de Julien, très
beau bébé dont le siège décomplété m’impressionna fort. À
Vincennes, j’avais compacté mes cours afin de me faire nounou de
notre fils. Rue du Calvaire nous disposions de quatre pièces, de
vieux poêles récupérés à droite et à gauche, de cheminées qui
ne tiraient pas, mais pas de salle de bain, pas d’eau chaude, pas
de toilettes ailleurs que dans la cour, et naturellement pas de
beaucoup d’argent, mais nous ne nous plaignions pas, nous
n’imaginions même pas que cette situation pût s’évaluer en
terme de durée. Au rez-de-chaussée habitait une grand-mère
adorable. Notre voisine originaire d’Italie était tout aussi
charmante, le quartier était épatant avec de nombreux commerçants
que nous connaissions bien dont un que nous soulageâmes de son stock
de Graves invendus, et pour nos promenades le jardin des Dondaines
était très grand alors. Les choses allaient en se densifiant
tellement que j’intégrai le vénérable cercle choral des XXX (des
trente) que présidait depuis la nuit des temps le bâtonnier Gaston
Rohart. Et pour ce qui est de la musique, toujours pas de rock mais
notre discothèque d’opéras que je constituais de semaine en
semaine après emplettes chez Gibert Joseph, boulevard Saint-Michel.
Il me faut aussi et surtout mentionner la célèbre Tribune des
Critiques de Disques qu’animaient Jacques Bourgeois, Antoine Goléa,
Jean Roy et Armand Panigel sur France Musique. À seize ans ça avait
été Salut les copains, dix ans plus tard cette réjouissante
tribune hebdomadaire me fut à son tour une école dont je tirai des
centaines de cassettes audio et de bandes magnétiques minutieusement
légendées.

Glen Matlock (The Sex Pistols ; The Mavericks)
~ 28 ~
Remonter
le fil du temps pour mettre un peu de chronologie dans son existence
n’est pas aisé. C’est partiellement faisable avec l’appareillage
technologique dont nous disposons mais je me demande si à un moment
donné l’entreprise ne finit pas par se retourner contre nous comme
on retourne un gant. Il me semble qu’arrivé à un certain point
l’observation de son existence ne peut que finir par perturber ce
que nous en attendions de netteté. Que nous le voulions ou non, la
continuité que nous cherchons n’est saisissable qu’à partir des
trous qu’y occasionnent les opérations de l’esprit. Et le rock
c’est comme les particules fines que crachent les pots
d’échappement des Harley Davidson. Cet été-là, comme les étés
suivants, Dan et moi encadrâmes un centre aéré, celui-ci
s’accompagna de la musique de David Bowie qui avait la cote auprès
de certaines jeunes monitrices. Avais-je déjà remarqué David Bowie
auparavant ? Son “look” androgyne plaisait aux jeunes monitrices,
oui mais look et connotation sexuelle associée n’étaient pas une
nouveauté ; depuis Elvis Presley, se faire tout image avait déjà
été une façon de s’anonymiser dans un trip d’éternité. Je ne
saurais dire les chansons que nous entendions de lui en cet été 76,
mais grâce aux ressources de la technologie qui voisinent avec
l’infini je suggère “Golden years”, ou “Young americans”
et “Fame”, titres qui figurent sur “ChangesOneBowie”, sa
première compilation, acheté ultérieurement. Quoique sa voix me
laissât parfois de marbre, j’accorde que David Bowie fit du bon
rock. Si je devais avoir des chanteurs préférés, il ne serait pas
du lot mais je n’en ai pas. Je crois que j’ai une certaine
tendresse pour ce qu’il faisait au début. Le meilleur des groupes
ou chanteurs de rock est souvent leur part inaugurale, ensuite ça se
tasse. Exception faite des Beatles qui n’ont jamais pris le temps
d’épuiser les Beatles.
Même époque (var.
Quand mon choix m’échut l’anchois déchut) : le disco, avec
Donna Summer, Gloria Gaynor, Earth, Wind and Fire, Amii
Stewart, Chic, Boney M ou Cerrone, tous noms que je ne retins qu’à
force de matraquage, exception faite des Bee Gees qui avaient déjà
épuisé les Bee Gees avec bonheur. Les Rolling Stones, Rod Stewart,
Kiss, Blondie ou David Bowie touchèrent à cette musique tant
qu’elle fut à la mode. À l’époque je détestais. C’est à
l’émission Soul Train que je dus de rendre au disco, musique à
côté de laquelle je passai de ce fait, ce qui revenait au disco. Je
me demande parfois ce que j’aurais écouté, ce que j’aurais fait
et partant celui que j’aurais été si j’étais né en d’autres
lieux, en d’autres temps, en d’autres conditions sociales, en
d’autres situations. L’absurdité de l’interrogation est-elle
si invalidante ? Un homme savant, un péquenaud, un mec pédant, un
saligaud ?... Non ? Ce que je serais capable de faire et de ne pas
faire en d’autres situations, je ne le sais pas. Est-ce que tout ça
ne fut jamais qu’une affaire d’enfance mal ficelée, cette
affaire de rock ? Et si elle n’est pas le fruit du hasard, ce n’est
pas de sa faute. Dans tous les cas, même métaphoriquement, ça
aurait été la musique, la musique qui aspire autant qu’on y
aspire. Une pierre qui roule comme a si merveilleusement chanté
notre rocker de Cro-Magnon. Après quoi le choix se prend des
guillemets dans les lattes. “Choix”, bien maigre “choix” à
vrai dire, il faudrait l’écrire en corps 6. En corps 6 ça donne :
“mon choix”. Le choix c’est comme l’être, faut gratter ! Si
je ne puis dire qui j’eusse été en d’autres temps et en
d’autres lieux, j’ai quand même une ou deux archées dans mes
présomptions. Le dernier disque en date que j’ai acheté est
“Elvis Club” des Del-Lords qui sur la ligne funambulaire du rock
tel qu’en lui-même (à ne pas confondre avec le rock funiculaire
qui lui fonctionne avec des ficelles) est toujours un bon groupe.
Leur interprétation d’“Everyday” de Dion DiMucci et Scott
Kempner, superbe, m’a tout de suite incité à revenir à Dion, un
chanteur qui aurait particulièrement fait l’affaire au sein des
Traveling Wilburys après la disparition de Roy Orbison (et de Del
Shannon [... mais avant celle de George Harrison qui conclut toute
alternative]). Le rock m’a-t-il révélé que la dissolution de
l’amour dans des refrains à deux sous, ça pouvait être ça la
vie ? Étonnamment, si de l’amour il n’y a rien à en dire, il y
a tout à en chanter : “Quand tes cheveux s’étalent / Comme un
soleil d’été / Et que ton oreiller / Ressemble aux champs de blé
/ Quand l’ombre et la lumière / Dessinent sur ton corps / Des
montagnes, des forêts / Et des îles aux trésors // Que je t’aime,
que je t’aime, que je t’aime, / Que je t’aime, que je t’aime,
que je t’aime !” : hexasyllabes et endécasyllabes. C’est parce
que tout l’amour suffit à ces quelques vers — l’équivalent de
l’accord de mi majeur à la guitare —, que les poètes n’écrivent
plus de poèmes lyriques.

Jim Thackery (The Nighthawks)
~ 29 ~
Alors
que je passais Grand-Place cet après-midi-là, un homme que je ne
connaissais pas m’offrit l’un des recueils de la pile qu’il
tenait contre sa poitrine : « Gaston Criel, “Popoème” », “Pop”
écrit en rouge, “oème” en blanc, pour que d’ouverture la
différence saute aux yeux (sinon en deuxième lieu “popo”, cf.
“... l’Harpic détartrant le popo-pipi de famille...” p. 17 et
“ème”). En 1976 c’était le giscardisme. Insouciants à
souhait, la pop d’alors et sa variante le disco assénaient l’air
du temps et il n’était pas dit que le poème ne s’inviterait pas
aux saturnales de la superfluité ambiante pour inverser le pas de
danse. Il allait de soi que les recueils de poèmes que cet homme
distribuait à la tête du client étaient de sa plume.
À Ludovic Janvier
qui, à Vincennes, nous avait proposé d’apporter de la matière
extraite de nos lectures afin que nous voyions de quoi il en
retournait, j’avais remis la photocopie de deux ou trois pages de
ce recueil. Malencontreusement, car Ludovic Janvier était vraiment
un très bon lecteur, je ne pus être présent le jour du compte
rendu qu’il en fit.
Avec son côté
manifestement beat, ou freak, ici fait de vers, là de proses, je ne
dégageai ce recueil du placard où je l’avais remisé qu’en
février 1980 (très exactement), suite peut-être à une soirée
passée à La Voie lactée où sa photo en quatrième de couverture
(nu comme un ver !) devenue poster m’avait rappelé à son bon
souvenir. Ce type était de toute évidence quelqu’un qui mettait
les pieds dans le plat, pour ne pas dire qui rentrait dans le lard :
société de consommation, servitude volontaire, aliénation,
duplicité, sexe, tout y passait sur un ton volontiers nihiliste,
vulgaire ou scato. S’il y avait une parenté qui justifiât un tel
jusqu’auboutisme c’est avec l’art brut. “Popoème” n’était
pas fait pour “être bien apprécié” comme l’écrivait dans sa
prière d’insérer José Millas-Martin, peut-être davantage pour
déplaire, mais d’abord il était fait de constructions syntaxiques
excluant tout raffinement, le vers devant être des plus élémentaires
: sujet, verbe, complément, et le lexique davantage redevable au
café du Commerce qu’à la poésie. Provoquer, tout était là.
Arguer en termes de lyrisme, de formalisme ou de modernisme eut été
vain, le centre de gravité de ce monsieur qui mettait la poésie à
poil était ailleurs. Après sa mort, le Conseil Régional envisagea
très sérieusement qu’un lycée à venir s’appelât lycée
Gaston Criel. Et là on se marre en pensant aux élèves étudiant
“Popoème” avec leur professeur de français : “Camille se
marie... On va à Pronuptia aussi à Prénatal... d’une bite deux
coups ! Les deux bonnes couilles du mariage dans la cible à mouflets
!”. Étonnez-vous qu’une œuvre poétique si souvent repoussée
derrière la biographie donna lieu à de telles bévues ! Mais
finalement ce lycée ne se fit pas.
C’est à nouveau
au bout de quatre ans, dès le tout début de notre aventure
revuistique, que Gaston et nous, nous trouvâmes et devînmes
complices. Il avait brièvement repris du service au “Café de la
plage”, le bar qui succéda à la défunte “Voie lactée”, mais
le lieu lui plaisait moins. Michèle, sa femme, qui avait été mutée
à Paris était revenue. Ah, Gaston avait une femme ? Oui, mais il
parlait si peu de lui, vous savez ! Chez Jacques Brémond était paru
peu de temps auparavant “Le Poète et ses poèmes”, tandis que
chez Samuel Tastet allait paraître en 1987 “L’Os quotidien” et
en 1988 une réédition de “Swing” : de cela, oui, il pouvait
parler, et de littérature, car là était sa vie. Avec la
démocratisation de l’accès à la photocopie, la multiplication
des petites revues permit à la poésie de tirer des derniers feux
avant l’internet une recrudescence éditoriale dont Gaston fit une
intense fréquentation.
La mort d’un poète
n’est pas triste au sens de la chanson de Mr Bécaud, “le monde
entier pleurait”, tu parles ! Il s’en fout le monde entier. Elle
est triste au sens où à la mort biologique, prévisible, inscrite
dans l’ordre du vivant, donnant du sens à la vie, succède pire
que l’oubli une autre mort que la poésie n’entrave plus. Le
langage n’étant plus un vecteur de parole, la parole n’en est
plus un de continuité, et la mort elle-même part à vau-l’eau,
inutile pléonasme. Qui parle encore d’Armand Olivennes, d’Hervé
Lesage, d’Alain Jégou, de Louis-François Delisse, de Michel
Valprémy, de Jean Rousselot, de Pierre Peuchmaurd, de Jean L’Anselme
et de tant d’autres qui ont creusé le sol dur de la langue pour
irriguer le vivant ? L’actualité est sans partage ; dans la plus
grande librairie d’Europe où Gaston ne manquait jamais d’aller
faire son petit tour on ne trouve plus un seul livre de lui depuis
longtemps. Nous, nous parlons de Gaston Criel. Gaston est des nôtres
et, quoique la poésie fût déjà hors-champ, son œuvre
poétique-littéraire parle pour nous ; il est devenu pressant de
ranimer la lampe mémorielle, de rappeler à nous nos fantômes aimés.

Otis Grand (and The Dance Kings)
En ce temps-là,
la gendarmerie prisait sûrement l’art lyrique puisque c’est sous la houlette
des anciens et amis que nous assistâmes aux représentations de “La Traviata” et
de “La Bohème”. Opéra de Lille puis pendant six ans Opéra du Nord, temps
giboyeux des “Tosca”, “Guillaume Tell”, “Traviata”, “Barbier de Séville”,
“Vaisseau fantôme”, “Prince Igor”, “Noces de Figaro”, “Boris Godounov”,
“Nabucco”, “Rigoletto”, “Barbier de Séville” à nouveau, “Thaïs”, “Il
Trovatore”, “Rape of Lucretia”, “Carmen”, “Faust”, “Samson et Dalila”, “Don
Giovanni”, “Eugène Onéguine”, “Werther” pour ceux dont je me souviens encore,
des récitals aussi dont celui de Teresa Berganza. Au théâtre Sébastopol qui
était depuis toujours l’alter ego de l’Opéra de Lille sur le versant de
l’opérette, nous eûmes le privilège de voir notre diva de prédilection
Montserrat Caballe. En 1998, l’Opéra de Lille fermera ses portes pour travaux
et nous passerons à l’Atelier lyrique de Tourcoing, fief de Jean-Claude
Malgoire, avec “Le Couronnement de Poppée”, “Orfeo” et surtout des Mozart et
des Rossini en veux-tu en voilà. La télévision étant alors profuse en
retransmissions d’opéras nous eûmes aussi, pour très peu de temps, juste ce
qu’il fallut de temps pour que nos fils ne s’y pendent pas, la télévision. Cette
luxuriance musicale accompagnait mes journées passées à dessiner et
réciproquement le dessin m’accordait tout loisir d’être au lieu où intérieur et
extérieur se confondent, à la fois dans mon occupation et excessivement loin,
l’un soutenant l’autre. Qui dira ce que mes dessins doivent à Iphigénie, à
Werther, à Rienzi, à Salammbo, à Thaïs, à Otello ?
Tout de
même, et je dois dire que je ne vois plus trop comment cela se fit, je revins à
la cause le temps de quelques concerts à la Foire commerciale : en 1979 AC/DC —
avec Bon Scott — que je tenais improprement pour un groupe de hard rock.
Toujours en 1979, en octobre, une moitié seulement du concert de Lou Reed, un
journal ayant mis en garde contre de probables aléas imputables à sa
cyclothymie, j’avais laissé Dan y aller avec des amis, ne me décidant en fin de
compte à m’y rendre qu’au bout d’une demi-heure. Concert puissant, je ne me
suis jamais désolé de n’avoir pas vu l’intégralité tant j’étais heureux de
n’avoir pas tout perdu. Rory Gallagher en janvier 1980, avec Elliott Murphy en
première partie, car Rory Gallagher ça avait été Taste et Taste c’était le
blues boom anglais des sixties, je connaissais le terrain. Salle de concert
pleine à craquer, pourtant qui se souvient de Rory Gallagher aujourd’hui
?
John Hammond
~ 31 ~
Le
rock se divise en deux : rock’n’roll et pop music, blancs et noirs,
progressistes et traditionnalistes, anciens et modernes, mods et rockers,
conservateurs et révolutionnaires, opportuns et opportunistes... grosso modo et
pour dire vite, car évidemment le partage ne s’arrête pas là. Ce qui est commun
aux uns et aux autres c’est l’histoire, le ciment, l’histoire qui fait et
défait la communauté des biens. Cette histoire n’a pas besoin de tomber du ciel
pour s’attribuer un début, discutable pour les tenants de Bill Haley en 1953,
indiscutable pour les autres, mais peu importe : 5 juillet 1954, Scotty Moore :
« Et soudain, Elvis a commencé à chanter “That’s all right” en sautant partout
et en faisant l’idiot, et puis Bill a pris sa basse et il a commencé à faire l’idiot
lui aussi, et j’ai commencé à les suivre. Je crois que Sam avait laissé la
porte de la salle de contrôle ouverte (...) il a passé la tête par
l’entrebâillement et il a demandé : “mais qu’est-ce que vous faites ?” Et on
lui a dit : “aucune idée”. Alors il a dit : “attendez un peu, essayez de
trouver un point de départ et recommencez” ». À cette histoire en tant
qu’histoire j’accorde une petite trentaine d’années d’existence, tant que dure
le ciment. Déjà en 1969, John Lennon : “The dream is over”, ou la même
année Meredith Hunter assassiné par les Hells Angels sous les yeux
des Rolling Stones au festival d’Altamont. Qu’un ver préexistât au fruit,
depuis l’assassinat de Sam Cooke, à quatorze ans j’avais compris ça. À la fin
des 70’s la fin de l’histoire du rock était entérinée, le punk rock avait réglé
son compte à la belle icône. Cela, évidemment, je n’en savais rien puisque je
n’en écoutais plus guère depuis un bon moment, mais si je l’avais su, ce n’eût
pas été une surprise. Le post-rock, libre d’accès, ne se lirait plus que dans
le désordre, j’y reviendrais en reconstituant ce que j’avais loupé avec les
morceaux épars.
J’en
viens pendant que j’y suis aux pages “Pop Music” de l’Encyclopædia Universalis
auxquelles j’accorde d’autant plus volontiers d’intérêt que les occasions
d’aborder le rock sous un angle critique qui soit à proprement parler critique
sont moins fréquentes que celles qui ont affaire aux panégyriques. Celles qui
nous occupent ici sont signées Gérard Jourd’hui, Paul Alessandrini et Christian
Lebrun. L’introduction s’attache au glissement sémantique du terme “pop music”
qui “aux États-Unis s’applique à l’ensemble de la musique de variété, tandis
qu’en Europe il remplace celui de rock music”, le phénomène social éclipsant le
phénomène musical à partir des années 50. De la façon la plus expéditive qui
soit, Gérard Jourd’hui met en corrélation le phénomène social et le capitalisme
: “la pop music n’est pas la musique de la jeunesse mais la musique pour la
jeunesse”. Elvis Presley, “idole préfabriquée du rock” ne trouve pas grâce à
ses yeux : “Frank Sinatra de cette génération”. En jazz, le “cool est
l’équivalent un peu plus sophistiqué de ce que sont les variétés pour les
classes moyennes. La bourgeoisie s’est emparée avec le hard bop du jazz
d’avant-garde”. Le rock’n’roll, quant à lui, est “la commercialisation évidente
du blues”. On apprend qu’Eddie Cochran “poussait encore plus loin que Presley
l’arrogance sexuelle de ses prestations scéniques”, sans blague, où Gérard
Jourd’hui est-il allé chercher ça ? C’est tellement sommaire qu’on se demande
comment l’Encyclopædia Universalis a fait pour trouver aussi médiocre
mémorialiste. Avec le passage des USA à l’Angleterre réduite aux Beatles, aux
Rolling Stones et aux Who ça ne s’arrange pas, Richard Lester devient le
cinquième Beatle à la place de Brian Epstein. Quand Gérard Jourd’hui alias Mr
Je sais tout s’abstient de développer ses propositions, il fait les questions
et les réponses. Ainsi quand il demande en conclusion : “Que deviendrait la pop
music si elle devenait le véhicule prépondérant des idées, au lieu de cacher
son insuffisance sous le masque de la nouvelle culture ?”. Parti du fait, selon
lui, que “l’apport musical de la pop music peut être jugé de faible
importance”, il ne lui laisse que l’alternative des idées, or les idées elles
ne les a pas. Conclusion, il ne lui reste pas grand-chose, pour ne pas dire
rien. Avant d’avoir le droit d’asséner une telle chose il avait le droit de le
démontrer. Démontrer en quoi des groupes comme “Blood, Sweat and Tears, Chicago
ou Pink Floyd ne sont que des faux semblants culturels, des ersatz de jazz ou
de musique classique”. Là où il pouvait nous parler de la mise en place de la
monopolisation de l’industrie du disque et des phénomènes de résistance qu’elle a pu susciter, il se contente de déballer ses préjugés qu’il nous demande de croire sur parole.
Plus sourcilleux,
Paul Alessandrini, qui fut membre de l’équipe de “Rock & Folk”
à partir de 1969 puis directeur de
collection chez Calmann-Levy où il publia et collabora à de nombreux ouvrages
sur le rock, dont un “David Bowie superstar” en 1984, évoque à propos de Bowie,
justement, parmi d’autres, les “manipulateurs du rock qui privilégient chacun à
leur manière la forme plutôt que le fond”. Prenant soin de préciser que
l’industrie du disque orchestre la dispersion, il accorde au punk rock d’avoir
été le ver du fruit conjointement à la nouvelle
génération de rockers qui, tant en Europe qu’aux États-Unis, s’est élevée à la
fin des 70’s contre le business de “la rock music programmée, sans âme”, ce que justement Gérard
Jourd’hui n’a pas pris le temps d’aborder. Ces articles de l’Encyclopædia Universalis datent
des années 80 ; presque quarante ans plus tard ce que je perçois de ce
qu’on appelle “rock” actuellement, de plus loin encore qu’à cette époque, a
évidemment beaucoup changé. Les modes l’ont relégué, et avec lui l’irréductible
légèreté du “shebam ! pow ! blop ! wizz !”, loin derrière les rap/hip-hop, electro, metal et
autres cover ou tribute bands. Pourtant je dirais qu’il a d’autant moins
vieilli que du court laps de temps qu’il a marqué de son insolente présence
d’esprit, du milieu des 50’s à la fin des 70’s, il n’en finit pas de donner le
ton.

|
|
|
Dave Kelly (John Dummer Band ; Blues band)
|
~ 32 ~
Il ne m’est pas difficile d’imaginer que
des lecteurs abusés par le titre du ci-présent, encore que le superlatif
“véritable” était susceptible de leur mettre la puce à l’oreille, n’auront pas
attendu d’aboutir à cette page pour s’en retourner à des occupations moins
dissidentes. Sauf à ne pas me souvenir de l’avoir souligné supra, car je n’en
suis encore qu’au stade du premier jet, j’aimerais revenir, à l’intention de
ceux qui restent, sur ce que patronne le rock qui fut, le dirai-je jamais
assez, l’article de mon émancipation. Sans le rock, il n’y aurait pas eu, en
tout cas dans les mêmes délais, de poésie, de philosophie, de perception
politique du monde, de non-conformisme, d’art lyrique, ni de musique en
général. Il y aurait eu le dessin, ça sûrement, quoique pas forcément le même
dessin. Le rock fut un vecteur de devenir. Le lecteur qui m’aura suivi
jusqu’ici conviendra que l’article du devenir, pour être vecteur, ne peut
qu’être combiné à d’autres articles. Le rock n’existe pas plus en soi que le
reste, il existe dans un agencement. Tout comme il y a une histoire de la
musique il y a une politique de la musique. Si l’histoire de la musique ne
nécessite pas de compétences particulières pour être globalement discernée, la
politique de la musique, elle, a priori insolite, est d’un abord moins usuel :
quel rapport politique et musique entretiennent-elles ? Plus brièvement, y
a-t-il une politique de la musique ? La politique s’est souvent intéressée à la
musique, — à l’art en général d’ailleurs, l’art étant chose trop importante
pour être laissé aux seules mains des artistes naturellement frivoles, trop
importante pour ne pas lui appliquer la clause économique du droit de regard.
De l’interdiction des représentations théâtrales publiques imposée pendant dix-huit
ans par le régime puritain de Cromwell aux “planifications”
communistes des musiques traditionnelles, les régimes totalitaires et
rigoristes ont toujours perçu que sans qu’elle ait besoin d’énoncer quoi que ce
soit, quelque chose d’autre, à la fois sensible et suprasensible, filtrait
d’elle. Pour les mollahs iraniens comme pour les puritains anglais du XVIIe siècle
ce quelque chose c’est tout ce qui excède l’étalon, tout ce transversal
(satanique, rétrograde, mystique, décadent) que ne peuvent qu’incarner et
véhiculer les minorités : féminité, fornication, homosexualité, prostitution,
etc. C’est ainsi que les mollahs iraniens n’ont pas hésité à interdire le rock,
la variété populaire et le droit pour les femmes de chanter en public. Plus une
seule chanteuse intra-muros depuis 1979 ! Quand on contraint la musique à
perdre de vue qu’elle est à elle-même sa propre mesure, ou sa propre démesure,
pour filer le train aux commanditaires de marches militaires, ça donne comme
dans le cas de la Révolution française des Philidor, Jadin, Candeille,
Dalayrac, Giroust, Méhul, Grétry, Boëldieu et autre Gossec : pas de quoi se
rouler par terre ! La situation de la musique en Iran n’est ni celle de la
musique à l’époque de la Révolution française ni celle de la musique soviétique
dialectiquement astreinte aux variations de prescriptions et de proscriptions,
mais quels que soient les cas de figures, d’elle n’en finit pas de filtrer
cette essence qui, dès que le trio Joubran, par exemple, se met à jouer, donne
à entendre la liberté pour la Palestine, ou dès que ces femmes d’Ouzbékistan
comme Munojot Yulchiyeva, de Mauritanie comme Malouma, du Kazakhstan comme
Uljan Baïbusynova, d’Éthiopie comme Hamelmal Abaté, du Kighizistan comme
Salamat Sadykova et tant d’autres, sourd l’égalité des droits pour les femmes.
Il n’est pas innocent que dans essence il y ait sens. Mais que dire, à
brûle-pourpoint, du sens et de l’essence ? Rien. Les concerts que donnent à
travers le monde les musiciens palestiniens, irakiens ou syriens résonnent infiniment
plus que tous les conciliabules politiciens, ils diffusent sans qu’il y ait
besoin de mots ce que nous comprenons fort bien, puisque justement la musique
c’est ça. Si la politique s’intéresse à la musique c’est parce que plus que
toute autre expression elle ne donne rien à voir et que, dans cette mesure qui
est celle de l’évocation, les choses les plus lointaines deviennent les plus
proches. La musique donne à entendre. Entendre au sens de comprendre et
comprendre au sens d’embrasser dans un ensemble. Entendre quand tout est obturé
c’est subitement élargir le cercle. C’est “Fidelio”, c’est Shostakovich
surgissant tel un titan de plus d’un demi-siècle d’éclipse soviétique, et c’est
pour en revenir à mes noirs moutons, au sortir de la seconde guerre mondiale,
de la guerre d’Algérie, de la guerre du Vietnam, le rock. Il y eut une
politique du rock que le rock politique n’apprivoisa ni ne contint.

~ 32 ~
Nous
sommes le 11 décembre 2020. Avec Arpo et Libelle, j’ai reçu ces
jours-ci comme un ultime reliquat de ma contribution à un bref instant de l’histoire
contemporaine du revuisme, Verso, la vénérable revue lyonnaise de poésie
qu’Alain Wexler continue d’animer et de m’envoyer, je n’ose croire en mémoire
des échanges de publications qui constituèrent l’âme de notre pratique
éditoriale, plus sûrement parce qu’il a oublié de me retirer de son service de
presse après que mes activités aient pris fin au terme de trente années bien
tassées. Verso, lui, c’est quarante-trois années sur le front qu’il
aligne. Que de temps passé à divulguer la présence en sourdine des poètes, quel
apostolat, n’est-ce pas ! Là, car à un moment donné il me faut boucler
cette histoire du rock, je me rends compte que je vais l’interrompre ici quand
débute, en 1984, notre propre aventure poétique. Non qu’à cette époque je
n’écoutais plus de rock mais son côté signifiant n’était plus le même, sans
doute parce que le temps de changer de disque était venu. Assez conjointement,
l’industrie du disque passée experte dans la gestion de l’offre et de la
demande à l’échelle planétaire l’avait dégagé de la subjectivation dont il
avait joui avec la sauvage rivalité des mods et des rockers, le déchaînement de
cohortes de filles en pâmoison devant leurs idoles ou le Swinging London. Aussi
l’enchaînement du rock avec la poésie a-t-il été l’illustration d’un processus
d’émancipation également passé par Mai 68 ou l’Université de Vincennes.
Quand j’ai entrepris notre odyssée, le
poème partageait déjà avec le rock de s’être largement dissout dans l’anodin, le
peu de répondant qui l’attendait n’était pas une surprise. C’est l’usage
naissant de la photocopie qui nous permit en des dizaines d’endroits en France et
de Belgique de nous faire un revival poétique à usage perso. Du poème et du
rock on n’aurait évidemment pu dire qu’il ne s’en écrivait plus ou qu’il ne
s’en jouait plus, bien au contraire ça grouillait, ce qu’il n’y avait plus
c’est l’anima historial qui leur avait conféré prestige et totale signification.
Le postpoème, comme le poème avant lui, est une extension sensible de la place accordée
à la nature, à la pensée, à l’esthétique, au politique. Nous comprenons que
s’il est postpoème plutôt que poème c’est parce que lesdites places ont cédé
leur prévalence à l’économicisme, au technologicisme et, pour rester dans les
ismes, au politicisme. Le grandiloquent vis-à-vis du nihilisme avec médias aux
ordres et cordons de CRS squattent les consciences en les retenant surtout de
s’aventurer en terra incognita : il n’y a plus de terres inconnues, qu’on
ne nous tarabuste pas avec des libertés qui n’ont plus cours ! Ce qu’il
faut au cerbère c’est réformer l’économie, assurer la sécurité de l’épargnant,
et surtout que nous ne sortions pas de chez nous ! Cela, à condition d’y aller
de notre préscience de voyant nous amène évidemment à d’inimaginables gouffres.
Finis le rock, le poème ? Finis. La
subjectivité les a emportés. S’il m’arrive encore d’acheter un disque de rock, invariablement
je reste sur ma faim, la magie n’opère plus, ou alors je me rabats sur des
oldies. Quant au poème, qu’il incline à la spiritualité psychotrope ou au
textualisme déclamatoire, j’ai suspendu. Il lui faudra faire de nouvelles
propositions avant que je n’y revienne. Quand il se sera rechargé, qu’un plein
de pure poésie l’aura envahi — je parle du monde — ou qu’une immense manif, un
raz de marée, aura fait que comme d’habitude tout s’arrange à la fin, que les
hommes s’entendent mais aussi s’écoutent et se comprennent, que les éditeurs
ouvrent grandes leurs portes à la jeune génération de poètes fédérée par un
esprit de fête, alors les temps seront mûrs pour célébrer des retrouvailles. Il
y a eu un âge des poètes et il y a eu un âge du rock, tout fait son temps et bien
peu vivent encore. Combien de musiciens avant lui n’ont pas attendu pour
éprouver ce qu’est de se consumer intensément ? Nos enthousiasmes n’ont
jamais cessé de prendre les devants en dépit des thuriféraires patentés et des mémorialistes
marchands de santons, le « rock’n’roll will never die » a vécu, c’est
son privilège que de reposer avec Beethoven.
FIN
de "La Véritable Histoire du rock"
*
Autres photos prises en concert
Photos Guy Ferdinande


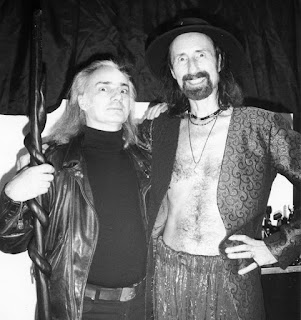












































































Pas s'ils sont censurés…
RépondreSupprimer